Lu dans Libération
"Ce qui incite un chercheur à chercher"
"J’essaie
de comprendre les systèmes d’incitation à la production de
connaissance. C’est une question clé dans le débat actuel sur
l’organisation de la recherche. Je l’explore au niveau, complexe, de
l’institution – l’organisme de recherche – qui met en œuvre des
mécanismes d’incitation, mais aussi plus simplement au niveau de
l’individu. Qu’est-ce qui pousse un chercheur à chercher ? Pourquoi
va-t-il choisir un sujet plutôt qu’un autre ? Avec qui va-t-il choisir
de travailler?
Des enquêtes de terrain, des plongées dans le microcosme de
laboratoires, mais aussi des données statistiques et des analyses
économétriques nous permettent de préciser les moteurs de ces
comportements. Il y a d’abord le plaisir de découvrir et de comprendre
pour la première fois ; il y a le désir de reconnaissance par ses pairs
et le corps social, et finalement vient l’argent: faire carrière, avoir
un bon niveau de salaire et pourquoi pas devenir riche.
Effets pervers. J’explore également l’effet sur la dynamique de
recherche des publications scientifiques, des brevets, et bien sûr, des
modes de financements. Qu’est-ce qui pousse un chercheur à publier
avant de breveter ? A s’associer avec un industriel plutôt qu’avec un
académique ? Est-ce que certaines innovations impliquent de nouvelles
recherches ? Et comment obtient-t-il les moyens de sa recherche ? On
compare les systèmes, d’une université à l’autre, d’un pays à l’autre,
pour essayer d’estimer leur efficacité. Là, les choses deviennent très
intéressantes dans la perspective d’une réflexion sur une réforme. Il
apparaît que les systèmes d’incitation doivent leur propriété à la
combinaison de plusieurs éléments. Alors que les politiques en quête de
réforme ont tendance à piocher un des éléments, en pensant qu’il est
indépendant des autres… au risque d’induire des effets pervers.
Ainsi, les Etats-Unis sont cités en modèle pour l’instauration du
financement de recherches sur des projets de deux ou trois ans,
proposés par un scientifique et acceptés pour financement par l’Agence
nationale de la recherche (ANR). Mais le financement sur projet,
outre-Atlantique, fonctionne dans un environnement totalement
différent. Nos études, parmi d’autres, l’ont montré. Là-bas, les
financeurs potentiels sont multiples, les fondations sont nombreuses et
en concurrence. Ici, un chercheur recalé par l’ANR a peu
d’alternatives.
Universités rentières. Par ailleurs, les universités américaines
sont des "rentières" qui ont les moyens d’assurer la continuité des
programmes d’actions (recherche comme formation) jugés essentiels.
Elles ont un patrimoine foncier, immobilier et financier qui se compte
parfois en milliards de dollars.
Historiquement, les «Land Universities» ont été dotées d’un vaste
patrimoine foncier dès leur création. L’université de Chicago est très
active dans la gestion immobilière d’une partie de la ville. Ensuite,
elles ont de l’argent de donations, souvent de leurs anciens étudiants,
qu’elles placent. Et finalement, elles prennent la part importante sur
chaque contrat passé avec un chercheur, parfois de 50 % ou plus, alors
que les organismes français prélèvent au plus 15 %…
En France, on introduit donc la recherche sur projet sans donner aux
établissements les moyens de pérenniser l’effort de recherche incité
par ces mêmes projets. C’est risqué. On peut regretter que cette
réflexion, fruits de nos recherches, ne soit guère prise en compte par
les politiques en amont des réformes.
Patrick Llerena est professeur des universités en
sciences économiques, directeur du Béta (Bureau d’économie théorique et
appliquée, UMR ULP-CNRS), à Strasbourg.
Recueilli par CORINNE BENSIMON
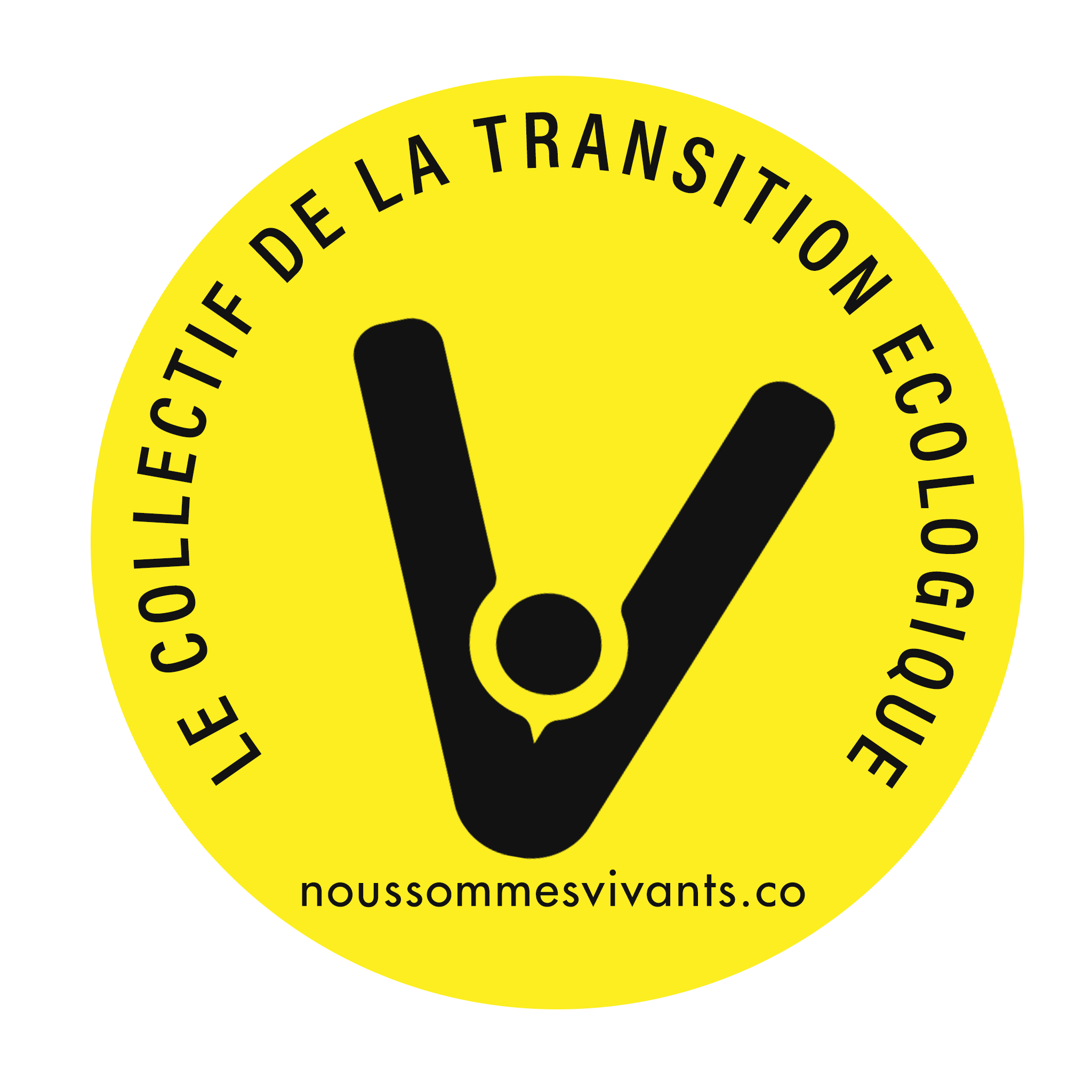
Laisser un commentaire