Lu dans Les Échos
Le bonheur n’est pas une idée neuve en économie. Le sujet rencontre
un intérêt croissant de la part d’experts et de responsables politiques
en quête de nouveaux objectifs pour l’action publique et d’indicateurs
alternatifs aux traditionnels agrégats économiques. Croissance, revenus
monétaires et PIB sont comme l’argent. Ils ne rendent pas
nécessairement heureux. Surtout, ils ne rendent pas compte de la
richesse humaine dans toute sa densité, ni ne permettent de préciser ce
qui fait ou non progrès, cohésion sociale, développement durable.
L’OCDE veut maintenant favoriser le progrès des sociétés, par-delà le
PIB. Une commission de très haut niveau a récemment été installée sur
ce sujet en France. Techniquement, il s’agit de savoir s’il est
possible de bâtir un indice synthétique de bien-être ou s’il faut
passer par une batterie de données différentes. Le sujet ne mobilise
pas que les économistes. Le très sérieux « Journal of Happiness Studies
» fait dialoguer les approches autour des caractérisations et des
enjeux du bonheur.
Le bonheur a fait récemment son retour dans
les études économiques. C’est que notent Luigino Bruni et Pier Luigi
Porta en ouverture de l’ouvrage qu’ils ont dirigé. Economistes,
sociologues et psychologues ne s’y distinguent pas véritablement par
leur discipline. Ils s’intéressent à cette branche de l’économie du
bien-être que l’on appelle désormais « économie du bonheur ». Leur
panorama est un état de l’art qui va d’une relecture de classiques
(Aristote, Mill Bentham) à la discussion des plus récents résultats
empiriques.
Bruni et Porta ont rassemblé les plus grandes
signatures contemporaines du débat. L’ensemble des contributions, à
vocation théorique, porte sur le « paradoxe du bonheur », connu
également sous le nom de « paradoxe d’Easterlin ». Au début des années
1970, Richard Easterlin a repéré que, dans un même pays, les riches
sont, à un instant « t », plus heureux que les pauvres. Quand un
certain seuil de revenu est atteint, le bonheur progresse peu.
Les
économistes du bonheur s’intéressent aux préférences subjectives des
individus. Celles-ci sont, en partie, inscrites dans nos gènes. Elles
sont aussi façonnées par les événements vécus et peuvent être modulées
par les politiques publiques. Elles relèvent de notre aptitude à nous
comparer. Le bonheur est ainsi lié à nos satisfactions et frustrations
relatives.
Le malheur peut provenir d’un trop grand engagement
dans la course aux gains. Il s’ensuit, selon les auteurs, des
propositions conservatrices (comme le soutien au mariage) ou
progressistes (comme la diminution du temps de travail). Easterlin, qui
ouvre la série des contributions, souligne qu’avoir une vie familiale
dense est plus important que de voir augmenter son revenu. Il invite à
une réallocation du temps en faveur de la famille, pour apporter une
issue au paradoxe qui porte son nom.
Contributeur de « Economics and Happiness », Richard Layard part encore du paradoxe d’Easterlin, qu’il place « au coeur de notre civilisation » dans
son ouvrage à succès, traduit en français (« Le Prix du bonheur »,
Armand Colin, 2007, 19 euros). Selon lui, il est scientifiquement
possible de mesurer le bonheur. Certes, il est plus difficile de
l’évaluer que de compter des lentilles. Mais on peut assez précisément
en apprécier l’intensité et les variations, par enquêtes d’opinion et
par encéphalogrammes (distinguant les empreintes cervicales de nos
émotions heureuses). Doté de cette possibilité de mesure objective,
Layard revient aux sources de l’utilitarisme et invite à ce que toute
politique économique se donne pour objectif le bonheur, et non la
croissance.
Les politiques devraient s’intéresser à ce que
valorisent vraiment les gens (la famille, les relations sociales, etc.)
plutôt qu’à la compétition des revenus et des positions sociales.
Layard observe que le chômage, le crime, les séparations conjugales
font plus pour le malheur qu’une simple diminution des revenus. Il
propose donc de tout faire pour mettre les chômeurs au travail. Pour
lutter contre le crime, il souhaite diminuer la mobilité quotidienne
des membres des familles modernes. Pour limiter l’instabilité
conjugale, il voudrait faire effectuer aux futurs parents des stages
autour de leurs droits et de leurs responsabilités. Layard critique
vivement la télévision. Celle-ci, en montrant richesse, gloire, beauté
et volupté, exacerbe le ressentiment de téléspectateurs qui sont loin
d’être aussi beaux, riches et heureux que les personnages des
publicités ou des séries…
La proposition la plus forte, et la
plus controversée, porte sur la fiscalité. Layard est favorable à une
lourde imposition marginale des heures travaillées au-delà d’un certain
seuil. Il veut restreindre le travail, une activité qu’il juge « addictive » et « polluante ».
Ce goût pour des impôts élevés s’explique aussi chez Layard par son
souci de redistribution. Il rappelle l’argument solide selon lequel
tout euro (ou tout dollar) supplémentaire apporte moins de bonheur
relatif à un riche qu’à un pauvre.
Arthur Brooks, qui travaille
notamment pour l’American Enterprise Institute, est en désaccord sur
bien des points avec Layard. Selon lui, on est plus heureux à droite de
l’échiquier politique. Les conservateurs se déclarent nettement plus
souvent heureux que les progressistes. Par ailleurs, plus les personnes
se déclarent libres, plus elles s’estiment heureuses : 93 % des
Américains s’estimant libres se disent heureux. A l’inverse, 23 % des
Américains se disant « modérément libres » ne se déclarent pas heureux.
Brooks observe que ceux qui appellent à plus d’interventions publiques
dans l’économie sont en général moins heureux. Et ce ne sont pas
nécessairement les plus défavorisés, a priori les plus malheureux.
A
l’échelle internationale, ce sont dans les économies les plus libres
que les populations se déclarent les plus heureuses. Une croissance de
1 point de l’indice de liberté économique (publié chaque année par le «
Wall Street Journal » et la Heritage Foundation) est associée à une
croissance de 2 points du bonheur déclaré dans la population.
Plus
qu’une corrélation, Brooks y voit un lien de causalité entre liberté et
bonheur. Il appuie son affirmation par certaines expériences de
psychologie sociale. En maison de retraite, par exemple, les personnes
les plus heureuses et les mieux portantes sont celles qui ont le plus
de marge de manoeuvre.
Brooks note encore que 43 % des croyants
se disent « très heureux ». Ce n’est le cas que de 23 % des laïques. Il
considère que ce n’est pas la liberté religieuse qui rend heureux, mais
la foi elle-même. Les croyants voient leur liberté utilement encadrée,
sans appeler d’intervention publique. Pour Brooks, qui juge son
raisonnement « très américain », notre bonheur, tant qu’il
repose sur des agissements qui n’ont pas d’impacts négatifs sur les
autres, ne saurait être encadré par des règles publiques, mais
seulement par des croyances auxquelles on adhère. La recette du bonheur
est une combinaison de liberté individuelle, de décence et de
modération. A ses yeux, le bonheur passe par la morale, avant de passer
par l’abondance. Les valeurs qui, aux Etats-Unis, favorisent le bonheur
sont la foi, la charité, le travail, l’optimisme et la liberté
individuelle. La laïcité, le souci de développement des politiques
publiques, l’addiction à la sécurité ne mènent pas au malheur, mais à
moins de bonheur. Brooks ne sera certainement pas traduit en français…
Ce
qui est certain c’est que les normes et les valeurs sont au centre de
la problématique du bonheur et, partant, de ses indicateurs.
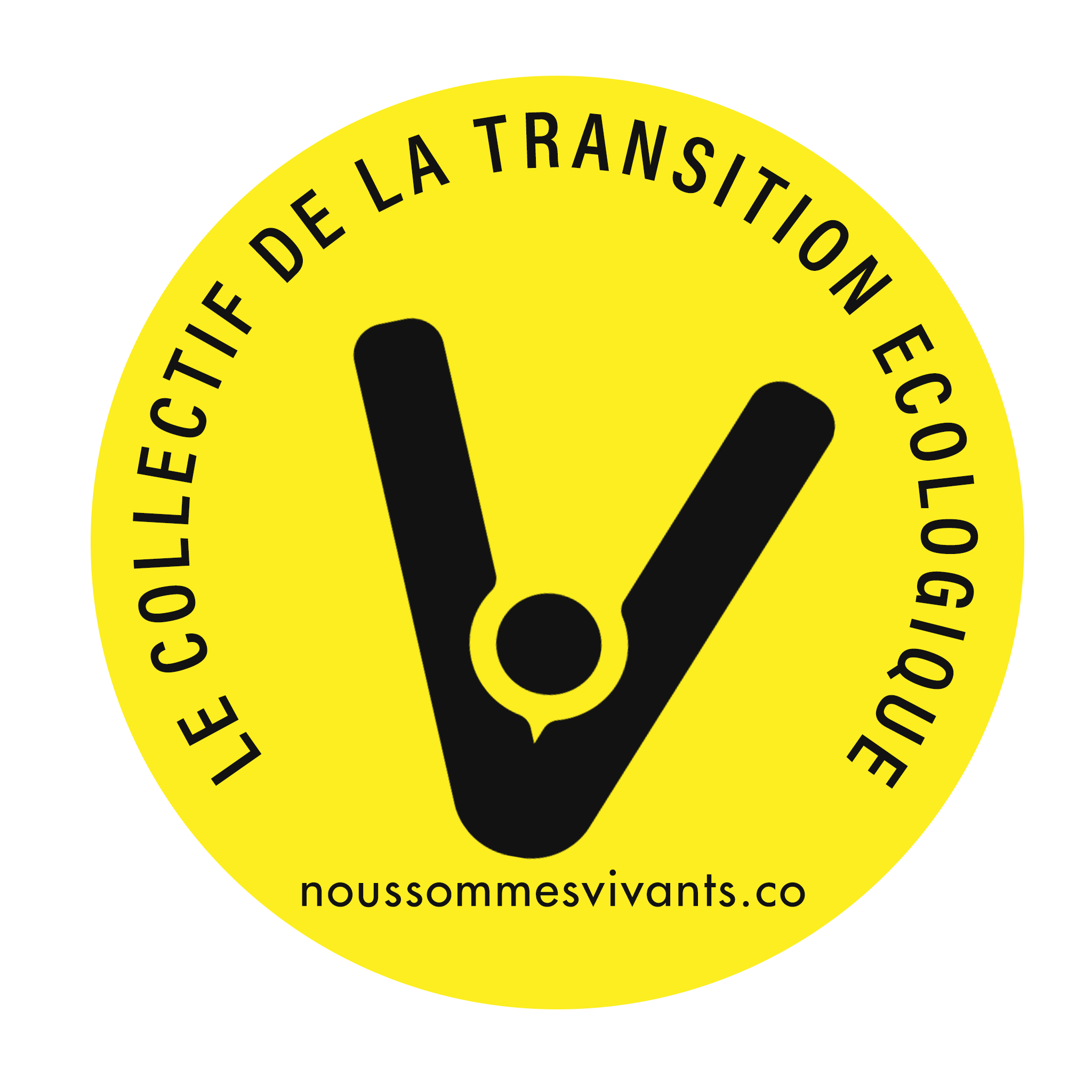
Laisser un commentaire