À
coup de clauses carnassières, l’industrie phonographique saigne à vif
les nouveaux entrants du marché e-musical et veille jalousement sur ses
rentes de situation.
La boîte de Pandora
Une
quelconque relation télépathique spéciale lierait-elle Steve Ballmer et
Steve Jobs ? Microsoft et Apple ont simultanément tilté sur la «
découverte musicale assistée par ordinateur ». Ma nomenclature
personnelle remplace cette barbare expression par « playlist
intelligente », concept qui concurrencera vite le mode shuffle ou random basculant de Madonna à Sparklehorse via Mozart et Françoiz Breut.
Connectés
aux nuages de données d’Apple et de Microsoft, les dernières versions
de iTunes et de Zune analysent algorithmiquement vos morceaux préférés
puis suggèrent automatiquement de nouveaux titres « que vous aimerez
»… À télécharger pour quelques micro-dollars. Les deux firmes ont
puisé leur inspiration auprès de la radio IP Pandora, pur produit du Music Genome Project
dans lequel analyses algorithmiques et humaines permettent de trier,
classifier et sélectionner les titres sur la base de 400 critères.
Grâce à ses approbations/rejets et notations des morceaux diffusés,
l’audionaute fournit de précieuses indications sur sa typologie
musicale. Ainsi, les serveurs de la station réactualisent régulièrement
sa bande-son personnelle avec une précision constamment accrue.
Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si la RIAA ne s’activait pas autant sous la table du législateur…
La
diffusion musicale par les stations américaines est considérée comme
une activité purement promotionnelle. Fortes d’un lobby radiophonique
très persuasif depuis les années 40, les FM n’ont donc pas de royalties
à reverser à l’industrie phonographique. Par contre, les radios
Internet/satellittaires sont soumises à un régime plutôt féodal :
-
une royalty de 0,0019 centimes par auditeur par titre instaurée en 2007 par le Copyright Royalty Board,
-
une royalty rétroactive de 0,008 centimes pour les années fiscales 2005-2006,
-
ainsi que sur les titres rejetés ou évités par leurs auditeurs.
Des
sommes plutôt infimes à première vue. Mais lorsque des milliers voire
des millions d’audionautes écoutent un firmament d’oeuvres musicales,
les montants à reverser prennent des proportions gargantuesques, au
point d’axphysier rapidement les radios Internet/satellittaires :
celles-ci devront payer entre 100 et 300% de leurs médiocres profits !
Stagnant dans une rentabilité très relative, elles perçoivent déjà
d’énormes parasites dans leurs fréquences : le CRB a planifié
l’augmentation des royalties de 6% et 8% respectivement pour 2010 et
2012. Comment en est-on arrivé là ? A cause de l’impossibilité des
radios satellittaires/Internet et des majors musicales de parvenir à un
accord, les secondes bénéficiant des oreilles et des bras longs des
sénateurs.
Au
départ, Pandora requérait une inscription payante afin que les
audionautes accède à ses playlists intelligentes. Sans succès.
L’intégration d’un modèle économique gratuit mais financé par la
publicité draina rapidement plus de 16 millions d’abonnés, la station
proposant de surcroît – comme beaucoup d’autres – le téléchargement des
morceaux streamés sur les sites payants iTunes, Amazon, etc. Dès lors,
les radios 2.0 ne remplissent-elles pas une fonction promotionnelle
plus directe que celle des radios hertziennes du fait de l’immédiateté
des hyperliens commerciaux ? A peine adolescents, les juke-box virtuels ne survivront-ils que dans l’antre d’un dragon de la Toile (Microsoft, Apple, Google, Amazon, etc) ?
Musique légale = suicide commercial
Considéré
auparavant comme une infâmie, le peer-to-peer est devenu un modèle
technologique prometteur. Rien de surprenant à ce que BBC iPlayer et
4OD (Channel 4) intègrent « un moteur Bittorrent », leur faramineux
succès causant même quelques clashs avec les FAI britanniques
confrontées à la voracité de ces catch-up TV
envers la bande passante royale. Les majors ont passablement compris
qu’il s’agit d’abord et surtout d’une technologie et non d’un vaisseau
cyberpirate. Toutefois, où sont les plate-formes P2P commerciales
dignes de ce nom ?
Certaines
plate-formes P2P ou classiques ont signé des contrats avec les majors
en toute intégrité et leur reversent des millions de royalties : Liquid
Audio, a2b, Lala, Qtrax, Mashboxx, Pandora et Comes With Music (Nokia).
Malgré une bonne presse, elles volent toujours au ras des pâquerettes.
D’autres ont plus ou moins réussi – légalement ou clandestinement –
avant de céder aux pressions judiciaires et aux clauses carnassières :
MP3.com, Myspace Music, Imeem et l’historique Napster ne sont plus que
des vaches à lait pour l’industrie phonographique; MP3tunes, Veoh,
Multiply et Seeqpod agonisent littéralement. Apparemment, à moins de
s’appeler iTunes, Amazon ou de figurer parmi de rares exceptions comme
eMusic, dur d’émerger significativement en partenariat avec les majors
dans le marché e-musical.
Première ligne du P2P légal, pas cher et sans DRM, « Wippit mort d’avoir voulu respecter les maisons de disques
», explique Guillaume Champeau (Numérama). Ennemi juré d’antan de
l’industrie phonographique quand il dirigeait Grokster et aujourd’hui
ex-patron de Wippit, Wayne Rosso reproche aux majors d’exiger « des avances scandaleuses qu’aucun investisseur ne tolèrerait, donc en étant aussi difficiles elles font fuir les investisseurs ». De plus, il ne voit aucun futur viable pour la musique commerciale en ligne : « Il
n’y a pas d’argent à gagner dans la vente de contenu. Le contenu est un
moyen pour une fin. En fin de compte ça sera financé par la publicité
et gratuit ».
Flibusterie.MP3
L’hésitation
voire la hantise du secteur phonographique pour le publi-financement –
comme pour la licence globale autrefois – s’explique aisément : les
clauses royaltivores, les taxations distributives évoquées précédemment
et les taxations progressives des objets nomades (taxes sur les
baladeurs, les téléphones mobiles, les mémoires USB, les boîtiers
multimédia, etc) garantissent ses colossales rentes de situation, et
ce, peu importe l’usage qu’en fera ou non le cybernaute. Les majors
veulent bien que les choses bougent en surface mais s’emploient
activement à ce que rien ne change en profondeur. Professeur de droit à
Temple University et spécialiste du copyright, David G. Post affirme à
juste titre que « les grands groupes qui traquent impitoyablement tout signe d’infraction ont la loi pour eux. Doit-on les laisser faire ? »
Quelques
années plus tôt, lors du boom biotech, la société civile mondiale
dénonça vivement l’inflation des brevets privés sur le vivant. Inspirés
par l’open source et les Creative Commons, des biolinuxes émergèrent
peu à peu afin de contrecarrer cette « gloutonnerie du brevetage privé » (cf. Danielle Auffray, Fiorello Cortiana et Alain Lipietz dans Le Monde du 15 mars 2005).
Copyrights perpétuellement étendus, droits d’auteurs renforcés à
outrance, clauses carnassières et royalties pantagruéliques : mêmes
modes opératoires, mêmes finalités. Pour ma part, l’audiopiraterie des
maisons de disques est à la culture musicale ce que la biopiraterie des
firmes biotech est aux sciences du vivant : un racket haute fidélité en
mode repeat.
Aux
yeux des majors, la gratuité apparente dévalue leur offre musicale d’où
leur lenteur opérationnelle et stratégique dans le cyberepsace. Elles
ont tort : le défi majeur du cybermarketing culturel repose beaucoup
plus dans le choix élargi et/ou personnalisé que dans la valeur
marchande, à fortiori dans un marché de niches par myriades. La preuve
flagrante par Pandora et les diverses radios 2.0.
Posté sur : le vide poches / marketing
Posté par : Loïc Lamy
Source: http://electrosphere.blogspot.com/2008/09/les-vautours-du-dcibel.html
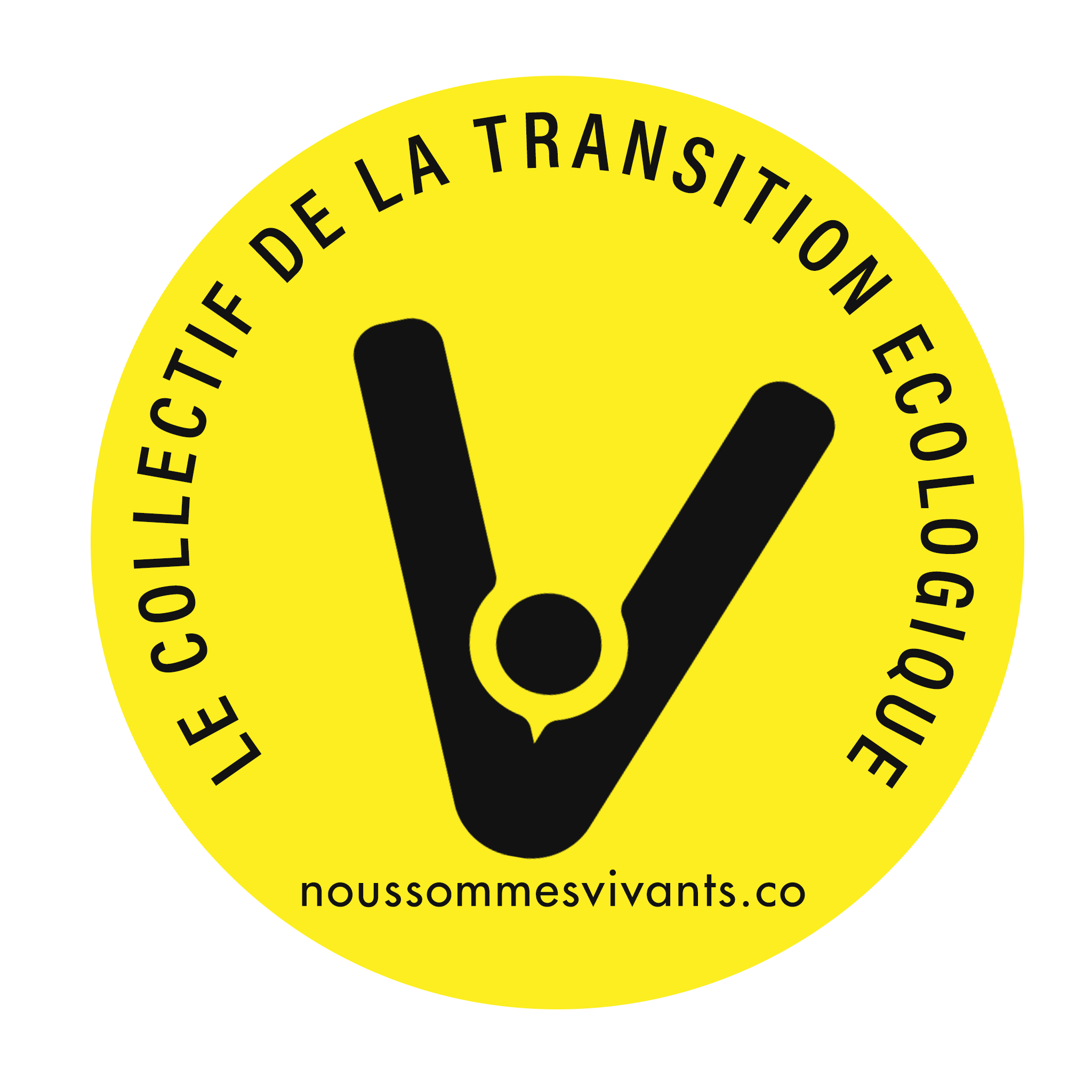

Laisser un commentaire