http://www.lacauselitteraire.fr/la-circularite-romanesque-au-xxeme-siecle.html
Diderot affirmait dans Jacques le fataliste : « Avec un peu d’imagination et de style, rien n’est plus aisé que de filer un roman ». Or, cette époque de « filer » une histoire avec une sainte intrigue en trois volets, est définitivement révolue. Tandis que le destin de « Jacques » semblait être subi par celui-ci comme une « fatalité », celui des personnages du XXème siècle s’emmêle, se défait, se délie, se désordonne, se perd sans jamais se filer, tout comme le texte lui-même. L’image d’un démiurge despotique et omniscient devient aussi incrédule que le mythe des trois parques qui « filent » le destin des humains, le compliquent puis finissent par le couper. Ainsi, les trois moments du roman traditionnel, le commencement, la crise et le dénouement, sont irrémédiablement mis à rude épreuve. À l’ère de l’inconscient, une ère où l’homme perd le contrôle sur cette force qui l’habite et le dépasse, les parques cèdent la place à une vieille myope, amnésique et à moitié folle qui ne cesse de s’emmêler avec les fils. Le texte ou le textile autrefois solide, fluide et bien tissé, se relâche, se troue, se défait, se délie et devient dentelle. Le roman n’est plus à « filer », mais à « dé-filer », le nœud de la vieille intrigue et son dénouement sont substitués par un réseau plus complexe, une infinité de nœuds dont ne se démêlent ni commencement ni fin. Face à la perte de repères et de mémoire, la vieille myope n’a qu’à revenir, défaire, refaire, répéter et ce à l’infini.
Plusieurs sont en effet les romans du XXème siècle qui relatent cette circularité creuse du roman. Elle n’est que la métaphore du pessimisme qui a largement régné en Europe après la Grande Guerre. Dans La Mise en scène, par exemple, Claude Ollier trace l’itinéraire de l’ingénieur Lassale qui part à Assameur pour faire une étude et y reviendra circulairement. Ainsi l’histoire aboutit-elle à une fin plus ou moins annoncée dès le début, le roman se fait l’écho d’événements joués d’avance.
Ayant perdu le respect du commencement et de la fin, ayant abandonné les formes caduques et stériles de la trinité, le roman innove en revenant sur lui-même. La forme circulaire est largement adoptée en ce qu’elle donne plus de liberté à l’écriture et minimise l’importance de l’intrigue qui n’est plus qu’une sorte d’accessoire. Toutefois, elle trace également un parcours romanesque fermé et non progressif. Le roman se transforme alors en un cercle vicieux, étouffant et infernal. C’est entre ces deux extrêmes antinomiques de l’image du cercle, entre une ouverture salutaire et prometteuse de renouveau et une fermeture infernale et stérile, que s’inscrit la littérature du XXème siècle.
1. La dysphorie néo-romanesque ou le cercle sisyphien :
Dans La Jalousie de Robbe-Grillet, la forme circulaire constitue une dérision de l’idée d’itinéraire : le roman se boucle sur son identité initiale. En effet, dans la première phrase du roman, on lit : « Maintenant l’ombre du pilier (…) divise en deux parties égales l’angle correspondant de la terrasse » (1) ; puis, à la fin du roman, on constate que Robbe-Grillet retourne à la description du même lieu : « Maintenant l’ombre du pilier se projette sur les dalles, en travers de cette partie centrale de la terrasse » (2). Cette reprise des mêmes notations semble anéantir toute notion d’événementiel ; aucun changement n’a été opéré entre le début et la fin, aucune conscience nouvelle n’a surgi. La circularité du récit, chez les nouveaux romanciers et notamment chez Alain Robbe-Grillet ne se contente pas d’être un simple accessoire, ou un caprice d’originalité. Elle obéit au contraire à une idéologie dans la mesure où elle se fait à l’image du vide de la réalité. En témoignent les propos de Robbe-Grillet lui-même, à propos de La Jalousie, lors d’un entretien pour l’Express :
Le journaliste : Alors, votre originalité n’est pas seulement de partir d’une forme vide, c’est d’y aboutir aussi. C’est de garder la « forme » en restant vide. Si je comprends bien votre préface, vous ne voulez pas faire une œuvre interprétable comme le serait Racine ; vous ne voulez sur le thème de la jalousie, faire une forme qui reste vide.
Robbe-Grillet : (…) Comme le serait la réalité (3).
Aussi, dans Angélique ou l’enchantement, l’écrivain reprend-il l’image hégélienne de l’anneau d’or :
C’est son vide central – une absence d’or – qui le constitue en tant qu’anneau, de même que le manque fondamental qui troue l’homme apparaît comme le lieu originel de son projet d’existence, c’est-à-dire de sa liberté. Seul en définitive un noyau de néant détermine son épaisseur concrète, et c’est l’absence d’être en son sein qui le projette hors de soi comme être-dans-le-monde comme conscience du monde, comme conscience de soi, comme devenir (4).
La circularité du texte correspond alors à l’enfermement de l’homme dans un univers de signes dépourvus de sens. Beckett dénonce avec plus d’acuité l’absurdité de l’action humaine. Dans Actes sans paroles, il reprend carrément le mythe de Sisyphe : un homme tente en vain de boire à une carafe qui descend vers lui mais remonte dès qu’il s’en approche.
Il va sans dire que ce vide existentiel de l’être qui répète et qui meurt en répétant affecte la structure même de l’œuvre dont la fin se dresse, se retourne et se referme sur le début. L’œuvre se fait à l’image du cercle infernal qui enveloppe les personnages. En attendant Godot nous offre un exemple parfait de circularité double. Les ouvertures des deux actes sont les mêmes ; le premier acte commence ainsi : « Route à la campagne, avec arbre. Soir […], entre Vladimir » ; et le second : « Lendemain. Même heure. Même endroit ». Et pour clore les actes, Beckett décrit le même décor en employant les mêmes termes. On lit à la fin du premier acte :
Estragon : Alors, on y va ?
Vladimir : Allons-y.
Ils ne bougent pas (5).
Et le second finit ainsi :
Vladimir : Alors, on y va ?
Estragon : Allons-y.
Ils ne bougent pas (6).
La circularité est dès lors enchâssée ; elle affecte la pièce entière, puisque rien ne se passe entre le début de la pièce et sa fin, et à l’intérieur de celle-ci, la circularité affecte les deux actes dans lesquels le début est le même que la fin. Le message de Beckett est clair : Godot ne viendra jamais car c’est avec lui que doit commencer l’anecdote ; dès lors, son attente ne peut aboutir qu’à une ultime déception.
Molloy présente également une circularité double, car le roman est constitué de deux parties. La première phrase : « je suis dans la chambre de ma mère » est en réalité un aboutissement, puisque toute cette partie raconte la recherche de la mère. Le roman commence donc par la fin. La seconde partie suit le même schéma. On voit Moran rentré chez lui pour écrire un rapport. Ce rapport raconte tout ce qui s’est passé pendant cette partie. Il n’y a donc pas un commencement, seulement des fins qui substituent le début ou plutôt qui l’effacent. En effet, la première phrase de la deuxième partie est la suivante : « Il est minuit, la pluie fouette les vitres » (7). La dernière phrase du roman vient annuler ce début : « Il n’était pas minuit. Il ne pleuvait pas » (8). La fin annule le début, mais le début annule également la fin en la contredisant. Sans commencement ni fin, le roman reflète la perte des personnages qui se heurtent à un monde illimité et qui dépasse leur action. Désespéré, Molloy essaye de s’expliquer le bouleversement de son univers et de celui de l’œuvre :
Car quelle fin à ces solitudes où la vraie clarté ne fut jamais, ni d’aplomb, ni la simple assise, mais toujours ces choses penchées glissant dans un éboulement sans fin, sous un ciel sans mémoire de matin ni espoir de soir. Ces choses, quelles choses, d’où venues, de quoi faites ? […] Oui, c’est un monde fini, malgré les apparences, c’est sa fin qui le suscita, c’est en finissant qu’il commença, est-ce assez clair ? (9)
Suscité par la fin, et finissant dans le commencement, ce « monde fini » ne peut qu’être circulaire. Mais est-il vraiment « fini », ce monde qui n’a ni commencement ni fin, ce monde dans lequel tout glisse « dans un éboulement sans fin » ? Ce qui est sûr, c’est qu’il échappe à tout contrôle. À défaut de pouvoir arrêter la roue, l’être sisyphien qu’est le personnage de Beckett, se résigne à continuer le cycle que le démiurge-dieu a tracé pour lui.
Dès lors, Beckett se trouve être le Nouveau romancier qui a donné le plus de relief à cette manière de nier l’histoire, parfois, la circularité touche à la construction même des phrases tel que la première phrase de Pour finir encore : « Pour finir encore crâne seul dans le noir lieu clos front posé sur une planche pour commencer » (10).
Cette sorte d’organisation en boule brouille les limites, fin et début se confondent, on ne peut plus savoir si le roman commence pour finir ou finit pour recommencer. En revanche, on sait incontestablement qu’entre les deux pôles du roman il y a un blanc, un vide que le romancier ne cherche pas à combler, mais plutôt à mettre en évidence. Dans Molloy, les phrases perdent toute possibilité de signification, elles sont là pour nier le sens : « Il est minuit, la pluie fouette les vitres. Il n’était pas minuit. Il ne pleuvait pas » (11).
Claude Simon réitère ce principe du cercle qui vide l’œuvre de tout contenu progressif (12). Dans La Route des Flandres, le récit commence et finit par le cheminement du colonel de Reixach dans la boue. C’est le romancier lui-même qui affirme la structure circulaire de son récit : « Le début, c’est Reixach sur la route et qui va être tué, la fin, c’est toujours Reixach sur la même route » (13). Entre début et fin, rien ne se passe, le roman se fait l’écho d’événements joués d’avance et qui se répètent inutilement. Mieux encore, dans la suite de la réflexion on comprend qu’entre début et fin ressurgit la mort : « on peut donc dire que tout le reste est une énorme parenthèse ouverte. Or, exactement au milieu du livre (bien que la précision de cette exactitude ait curieusement résulté d’une série de ratures, de rajouts et de corrections qui avaient de tout autres motivations), il y a anéantissement de l’escadron qui tombe dans une embuscade. C’est donc le thème de la mort qui resurgit au centre » (14). La viduité de ce roman nous est annoncée dès l’exergue : « Je croyais apprendre à vivre, j’apprenais à mourir ». Ces mots empruntés à Léonard de Vinci nous mettent en garde, car il ne s’agit pas de raconter une vie, mais une mort. Il ne s’agit pas de construire une histoire, un roman, une œuvre, mais de réitérer ce qui déjà n’est plus, de ressasser l’arrêt, l’inaboutissement, l’échec. Le dernier paragraphe de La Route des Flandres vient appuyer ou simplement répéter cet état d’arrêt :
[…] bercé par le martèlement monotone des sabots des cinq chevaux piétinant leurs ombres ne marchant pas exactement à la même cadence de sorte que c’était comme un crépitement alternant se rattrapant se superposant se confondant par moments comme s’il n’y avait plus qu’un seul cheval, puis se dissociant de nouveau se désagrégeant recommençant semblait-il à se courir après et cela ainsi de suite, la guerre pour ainsi dire étale pour ainsi dire paisible autour de nous, le canon sporadique frappant dans les vergers déserts avec un bruit sourd monumental et creux comme une porte en train de battre agitée par le vent dans une maison vide, le paysage tout entier inhabité vide sous le ciel immobile, le monde arrêté figé s’effritant se dépiautant s’écroulant peu à peu par morceaux comme une bâtisse abandonnée, inutilisable, livrée à l’incohérent, nonchalant, impersonnel et destructeur travail du temps (15).
En nous apprenant la mort de tout, ce dernier passage se fait l’écho du « j’apprenais à mourir » initial. Le bruit est « creux », comme une porte dans une maison « vide ». Le ciel est « immobile », le monde entier est « arrêté figé », et même la guerre est « paisible ». La seule chose qui paraissait jusque-là vivante, le mouvement du cheval, est rattrapée par cette atmosphère générale : « piétinant, alternant, se rattrapant, se superposant, se confondant, se dissociant, se désagrégeant, recommençant ». Or, le recommencement du mouvement ne peut conduire qu’à la monotonie : « martèlement monotone », un autre visage de l’immobilité. La mort habite le mouvement, si répétitif et multiple soit-il. L’œuvre est, comme cette bâtisse « abandonnée, inutilisable », abîmée par le temps qui la détruit en faisant revenir éternellement le même mouvement. Car si le temps est destructeur, c’est dans cette mesure qu’il l’est. La fin est devenue un « espoir » inatteignable. Mais la non-finitude, n’est-ce pas le graal que personnages et écrivains recherchent ? Certainement pas, car il s’agit là d’une éternité sisyphienne, de damnation et non de salut. Claire Guizard, reprenant l’analyse de Bonnefis, explique ainsi la dimension négative de l’absence des confins dans l’écriture simonienne :
L’origine du temps est impensable parce que comme le souligne Philippe Bonnefis les romans simoniens thématisent une « structure d’universelle antécédence », « on est toujours le second », « on vient toujours après » (16), et la fin du temps est oblitérée ainsi que l’illustre le déboulonnage de la statue « LES TEMPS FUTURS », réquisitionnée au titre des métaux non ferreux durant la guerre et dont il ne demeure que le socle « seul, vide » (17).
Posséder l’éternité, c’est posséder à la fois le passé et l’avenir, le début et la fin ; or, « sans passé ni futur » (18), la circularité simonienne est, à l’image de ce socle, « vide ». Par ailleurs, les expressions qui abolissent le commencement et la fin sont toujours associées non pas au contrôle de l’avenir, mais à l’égarement : « sans commencement ni fin ni repère » (19). S’explique dès lors l’embrouillement des personnages « confondant passé présent et futur » (20) et qui ne savent plus s’ils sont « le lendemain et non pas la veille, ou encore le même jour » (21). « Comment savoir ? ». La fameuse question reste tenace et les tentatives d’y répondre butent contre l’erreur ; alors l’errance continue. Elle continue parce que trouver et chercher signifient la même chose, expriment le même mouvement qu’errer, un mouvement principalement circulaire. C’est Maurice Blanchot qui nous l’apprend :
Je me rappelle que le mot trouver ne signifie d’abord nullement trouver, au sens du résultat pratique ou scientifique. Trouver, c’est tourner, faire le tour, aller autour. Trouver un chant, c’est tourner le mouvement mélodique, le faire tourner. Ici, nulle idée de but, encore moins d’arrêt. Trouver est presque exactement le même mot que chercher, lequel dit : « faire le tour de ». Trouver, chercher, tourner, aller autour : oui, ce sont des mots indiquant des mouvements, mais toujours circulaires. Comme si la recherche avait pour sens de s’infléchir nécessairement en tournant. Trouver s’inscrit sur cette grande voûte « céleste » qui nous a donné les premiers modèles du mouvant immobile. Trouver c’est chercher par le rapport au centre qui est proprement l’introuvable […]. La recherche serait donc de la même sorte que l’erreur. Errer, c’est tourner et retourner. S’abandonner à la magie du détour. L’égaré, celui qui est sorti de la garde du centre, tourne autour de lui-même, livré au centre et non plus gardé par lui (22).
Avec l’expression « livré au centre et non plus gardé par lui », l’errance prend la dimension de la damnation. Narrateur, personnage et lecteur semblent être condamnés par quelque divinité, un centre, à errer dans un labyrinthe sans issue possible. Pis encore, il est évident qu’il n’existe pas pour eux d’autre mode opératoire que d’errer. En effet, puisque sur la circonférence du cercle tous les points sont égaux – chercher et trouver ont le même sens –, tout but devient dérisoire. C’est dans la combinaison entre l’obligation d’errer et l’absence de finalité que la condamnation puise sa dimension tragique. Les acteurs de cette tragédie n’ont qu’un espoir : finir. Malheureusement, la « force déchaînée » qui produit l’œuvre est « condamnée à s’épuiser sans fin, sans espoir de fin » et même si nous l’oublions, le dénouement du Vent s’obstine à nous le rappeler :
Par-delà le temps, le silence : tout de nouveau dans l’ordre réformé, indestructible, jusqu’au vent lui-même, de nouveau là, les premières rafales du vent d’automne […] il serait de nouveau installé […]. Bientôt il soufflerait de nouveau en tempête sur la plaine […] force déchaînée, sans but, condamnée à s’épuiser sans fin, sans espoir de fin (23).
L’absence de fin signifie-t-elle l’éternité ? Certes, mais une « mauvaise éternité ». Il s’agit en effet de la perpétuation du vide. La répétition de l’expression « de nouveau » témoigne paradoxalement, non de la nouveauté, mais du retour de l’ancien. L’image du vent souligne l’effet destructeur d’un retour stérile. Ce passage, censé constituer le dénouement du Vent, n’en est un qu’en apparence ; il ouvre sur la répétition de ce qu’on vient de lire. La circularité de l’œuvre souligne ainsi la stérilité du retour : l’œuvre inaboutie fait appel à une nouvelle tentative de sa propre construction, mais la « force déchaînée » du vent ravage tout sur son passage. « Condamnée à s’épuiser sans fin, sans espoir de fin », l’œuvre est contrainte à réitérer l’échec qui la constitue.
2. L’ouverture salutaire du cercle :
Face aux déclarations de certains Nouveaux romanciers, on peut affirmer qu’ils ont puisé la circularité du récit dans l’œuvre de Proust (24). En effet, le début de la Recherche du temps perducommence à la fin, quand le narrateur se met à écrire le roman que l’on vient de lire, « le cercle est ainsi fermé entre la fin et le début (…). Il s’agissait donc bien d’une fin, écrite presque pour commencer » (25). Dans une lettre de 1919 à Paul Souday, Proust écrit :
Le dernier chapitre du dernier volume, a été écrit tout de suite après le premier chapitre du premier volume. Tout l’entre-deux a été écrit ensuite (26).
Dès lors, on comprend que le début et la fin traitent presque des mêmes sujets ; la matinée chez les Guermantes rassemble presque tous les personnages que Proust avait anticipés tout au long de son livre et c’est grâce à cette matinée que le narrateur se remémore son enfance qu’on a déjà lue dans « Combray ». C’est ce que Proust a annoncé à Benjamin Crémieux : « La dernière page du Temps retrouvé (écrite avant le reste du livre) se referma exactement sur la première page de Swann ». Proust met en place un système scriptural défini par le retour au même : l’œuvre s’ouvre sur l’arrivée de Swann et le baiser du soir et se referme sur les mêmes thèmes. Par ailleurs, dès les premières pages qui évoquent les réveils nocturnes, la conscience ne se projette pas dans l’avenir, mais revient à son passé : l’enfant qui monte dans sa chambre est évoqué par l’homme qu’est devenu cet enfant, une fois cette vie a été vécu :
Il y a bien des années de cela. La muraille de l’escalier où je vis monter le reflet de sa bougie n’existe plus depuis longtemps (27).
Fasciné par cette structure circulaire de la Recherche, Alain Robbe-Grillet, en l’évoquant, assimile sa clôture à celles des œuvres néo-romanesques. Il y voit une destruction du roman qu’on vient de lire, une sorte d’éboulement qui engloutit les thèmes qui précèdent :
La fin de la Recherche, loin d’être un temps retrouvé, bien assis sur la certitude, est un engloutissement. Les commentaires de Proust sur la tétralogie de Wagner, on peut les appliquer à sa propre œuvre : le Temps retrouvé, c’est le Crépuscule des dieux ; c’est-à-dire le moment où tous les thèmes reviennent, magnifiés, amplifiés, splendides, et en même temps détruits. Tout roule, se désagrège dans le formidable océan (28).
Plus loin, Robbe-Grillet s’est explicitement inscrit dans la lignée de Proust en comparant la fin de la Recherche à celle des Gommes : « La Recherche du temps perdu, elle, n’est pas dominée », sa fin est comme celle des Gommes, là où on est face à « des petits éléments qui participent d’une certaine façon de cet échec à dominer l’œuvre : des petits bouchons qui surnagent, des objets qui arrivent à la surface et qui flottent » (29).
Pourtant, la circularité de la Recherche n’est pas de la même nature que celle du Nouveau Roman. Si Proust a conçu son récit selon ce schéma c’est parce que le sujet de l’œuvre l’imposait : laRecherche du temps perdu ressemble à une quête du Graal parce que son histoire est celle d’un homme qui cherche un sujet pour écrire un roman et que ce sujet se découvre à la fin de l’œuvre : la vie que cet homme avait menée jusque-là. Donc, la circularité est étroitement liée au sujet de l’œuvre ; c’est ainsi que Compagnon l’avait interprétée :
À la fois préalable et postérieure, prospective et rétroactive (…). Elle devait raconter l’histoire d’une vocation afin que la découverte après coup de l’unité de la vie par le héros fût le principe déjà mis en œuvre par le narrateur durant tout le livre, à l’insu du lecteur (30).
Cette nécessité thématique de la structure circulaire est absente chez les Nouveaux romanciers. Pour eux, il s’agit simplement d’une stratégie à travers laquelle ils affirment la négation de l’anecdotique et donc le vide existentiel de l’homme. Or, chez Proust, le retour à l’ouverture du roman ne produit pas un effet de vide ; au contraire, cette circularité donne du relief à la réalité. En effet, Proust y ajoute l’élément du temps : il est vrai que l’intrigue traditionnelle est absente de la Recherche parce que Proust ne raconte pas des événements, mais il s’agit bien de l’histoire d’une personne dans le temps, l’histoire d’une maturation. Du temps perdu au « Temps retrouvé » s’opère une découverte progressive de la réalité, « Combray » fait revivre le mythe platonicien de la caverne, ce passage progressif, par une suite de réveils, des illusions à la vérité. Toute la Recherche met en scène une suite de découvertes, qui finit par dévoiler la vraie vie : l’art. Dès lors, comme disait Michel Raimond, « ce qui fait le roman et ce qui le tient debout » est « ce passage d’enfance à maturité » (31).
Au début du roman, l’apparition des personnages est une rencontre avec l’inconnu, le narrateur les peint tels qu’il les voit, mais il ne les connaît pas. Dans Le Temps retrouvé, il ne les reconnaît plus. Ce fut le cas pour sa rencontre avec Gilberte, semblable à une première fois :
Une grosse dame me dit un bonjour, pendant la courte durée duquel les pensées les plus différentes se pressèrent. J’hésitais un instant à lui répondre, craignant que, ne reconnaissant pas les gens mieux que moi, elle eût cru que j’étais quelqu’un d’autre (…). Et je reconnus Gilberte (32).
Ce spectacle de renouvellement, ce recommencement qui paraît comme une nouveauté perpétuelle, donne au lecteur une impression du retour au niveau à partir duquel le roman vient d’être entrepris ; cela paraît donc contradictoire avec le projet de Proust, de « décrire les hommes comme occupant une place si considérable, à côté de celle si restreinte qui leur est réservée dans l’espace, une place au contraire prolongée sans mesure (…) dans le temps » (33). Cependant, la contradiction n’en est une qu’en apparence, car si le narrateur ne reconnaît plus Gilberte, c’est parce que le temps l’a changée. Le temps dans la Recherche est donc actif, il agit sur les êtres et les transforme. Cela a été constaté par Beckett qui affirme à propos de l’action du temps sur les personnages de laRecherche : « nous ne nous échappons pas d’hier car hier nous a déformés » (34). Proust opère donc une transformation extérieure sur ses personnages pour montrer que le moi physique des êtres se transforme avec les années. A contrario, chez les Nouveaux romanciers, les mêmes situations stagnent et produisent un sentiment de malaise chez le lecteur face à une absence totale du changement. Dans Projet d’une révolution à New York, on a l’impression que Robbe-Grillet recommence son récit à chaque fois qu’il le pouvait. Le recommencement cyclique et répétitif aboutit à une sorte de « paralysie » du texte incapable de progresser :
La première scène se déroule très vite. On sent qu’elle a déjà été répétée plusieurs fois : chacun connaît son rôle par cœur (…). Puis il y’a un blanc, un espace vide, un temps mort de longueur indéterminée pendant lequel il ne se passe rien, pas même l’attente de ce qui viendrait ensuite. Et brusquement l’action reprend, sans prévenir, et c’est de nouveau la même scène qui se déclenche, une fois de plus… mais quelle scène ? (35)
Dire qu’il y a une première scène, c’est en supposer au moins une seconde. Rien, cependant, dans la suite du livre qui en porte la marque : même le « blanc » annoncé et « le temps mort indéterminé » sont impossibles jusqu’à la fin du récit. Et lorsque l’action reprend, il s’agit, une fois encore, selon une mise en place d’un processus circulaire, de la première et donc unique scène. Jean Ricardou atteste, à ce propos, que le début et la fin sont en état de symétrie inverse :
Le début est prospectif : il commente une scène à venir et lance la lecture, la fin est rétrospective, elle suppose un prolongement antéposé, un fragment, en le corps du texte, qu’il est désormais possible de lire autrement (36).
Ricardou laisse entendre que le schéma circulaire n’est qu’une invitation à relire le texte, ce qui n’est pas faux ; cependant, il faut aussi ajouter que si Robbe-Grillet invite à relire son texte, il ne peut proposer au lecteur, à chaque nouvelle lecture, qu’un vide absolu, un « temps mort », et un blanc qui ne cesse de revenir. À l’image du texte, la lecture serait, par conséquent, cyclique et stérile. Elle est condamnée à se répéter sans évolution possible.
Proust, au contraire, insiste sur l’existence d’une durée et non d’un blanc entre le début et la fin de son œuvre. Le temps, ignoré par Robbe-grillet, joue un rôle essentiel dans la Recherche, comme l’a déjà souligné Gaëtan Picon :
[Proust] s’apprête à séparer le présent et le passé, et à installer dans cet espace la coulée, la durée de son œuvre. Et ce que nous retenons d’elle enfin, n’est-ce pas cette traversée qui nous rend sensible le temps dans son épaisseur et son cours ? (37)
Dès lors, c’est le temps qui donne un sens à l’œuvre : le roman est essentiellement fait dans le temps.
Claude Simon, de son côté, ne nie pas le temps, mais le met en scène comme un agent néfaste pour l’homme et le monde. Du coup, le travail destructeur qu’opère l’écrivain dans son œuvre par le biais de la circularité reflète le travail destructeur qu’opère le temps dans le monde. C’est la raison pour laquelle, à la fin de La Route des Flandres, Simon explicite cette idée qu’il se fait de l’effet fatal du temps :
Le monde arrêté figé s’effritant se dépiautant s’écroulant peu à peu par morceaux comme une bâtisse abandonnée inutilisable, livrée à l’incohérent, nonchalant, impersonnel et destructeur travail du temps (38).
Par-là, on est relativement proche de la conclusion que fait le héros du Temps retrouvé. En effet, pendant la matinée chez les Guermantes, il rencontre des personnes qu’il n’a pas vues depuis longtemps et se montre frappé par leur vieillissement ; ainsi il prend conscience de l’idée de la mort. Aussi, l’oubli a-t-il tout enseveli, tout nivelé. Plusieurs fois le nom d’Albertine revient mais ne provoque même pas, chez Marcel, ce petit pincement au cœur que le lecteur attend : tout est mort, même le souvenir ; telle est la leçon de l’éternel retour non seulement des êtres, mais aussi des impressions et des pensées. Cependant, contrairement au narrateur simonien qui abandonne son récit au temps qui le démolit, chez Proust, à la découverte de l’idée de la mort, le narrateur a compris qu’il faut écrire une œuvre pour triompher de l’oubli, pour fixer les moments de bonheur et empêcher le temps de tout dévaster. Le temps perdu est retrouvé grâce à l’écriture :
Enfin cette idée du temps avait un dernier prix pour moi, elle était un aiguillon, elle me disait qu’il était temps de commencer (l’écriture de mon œuvre) (39).
Dès lors, avec une telle détermination, on est très loin de la dysphorie finale qui caractérise La Route des Flandres parce que l’art véritable – ici la littérature – est éternel. L’artiste ne craint la mort que dans la mesure où elle peut l’empêcher d’achever son œuvre, seule condition de sa survie éternelle :
Je recommençais de nouveau à la craindre (la mort), sous une autre forme il est vrai, non pas pour moi, mais pour mon livre, à l’éclosion duquel était au moins pendant quelque temps indispensable cette vie que tant de dangers menaçaient (40).
Il est vrai que l’écoulement du temps nous rapproche de notre fin, mais l’écriture nous préserve de la mort. Car, on lègue notre moi profond, c’est-à-dire notre vrai moi (41) dans l’œuvre que l’on crée. Le temps ne détruit que notre moi physique et superficiel. Aussi, le temps proustien est-il positif : il n’annule pas les expériences précédentes mais les transforme, les enrichit et c’est ainsi qu’entre le début et la fin il y a une pensée qui se consolide jusqu’à maturité.
Dès lors, on peut observer que les Nouveaux romanciers, en utilisant ce procédé, ont affirmé le contraire de l’idée proustienne, puisqu’à travers la circularité, ils ont abouti à démontrer une ankylose et non une évolution. Mais ce qui reste évident, est que la circularité est double : le roman se retourne sur lui-même, mais aussi la littérature. Au même titre que les romans qui commencent pour « finir encore » et finissent pour recommencer, les écrivains avancent à reculons. Une manière de nous dire qu’écrire n’est jamais un acte qui se fait ex-nihilo ou de manière autonome, écrire est coexister avec ceux qui nous habitent, y revenir pour s’y voir, écrire est un « un miroir qui revient ». Telle est la leçon de Robbe-Grillet à la fin du Miroir qui revient. Il met en valeur un schéma circulaire qui marque un retour, non au début du roman mais à l’œuvre de Proust. Le « miroir » revient en effet au célèbre épisode du thé à la madeleine :
Grand-mère (…) a demandé : « Alors, on ne prend pas le thé, aujourd’hui ? » Sa fille lui a répondu avec agacement : « Mais on vient juste de le prendre ! Il est fini, le thé ! » Après un instant de réflexion, grand-mère, de cet air hautain qui plantait désormais sur sa tête perdue, a dit comme pour elle-même : « imbécile, va ! Le thé, ça n’est jamais fini » (42).
Oui, le « thé ça n’est jamais fini » tant qu’« écrire » reste un verbe indomptable qui ne se conjugue qu’au pluriel : « écrire avec ».
Notes :
(1) Alain Robbe-Grillet, La Jalousie, op. cit., p. 9.
(2) Ibid., p. 210.
(3) Article publié initialement dans l’Express en 1959, puis dans Le Voyageur, op. cit., p. 298.
(4) Angélique ou l’enchantement, Paris, Minuit, 1987, p. 22.
(5) Beckett, En attendant Godot, Paris, Minuit, 1952, p. 9 et p. 79.
(6) En attendant Godot, op. cit., p. 75 et 134.
(7) Molloy, op. cit., p. 125.
(8) Ibid., p. 239.
(9) Ibid., p. 59.
(10) Beckett, Pour finir encore, Paris, Minuit, 1976, p. 7.
(11) Beckett, Molloy, op. cit., p. 272.
(12) Par sa conception cyclique de l’Histoire, Claude Simon s’oppose fortement à Hegel, qui, bercé par le rêve encyclopédique, développe une théorie du progrès historique.
(13) Lire Claude Simon, colloque de Cerisy, textes réunis par Jean Ricardou, Paris, Les Impressions nouvelles, 1986, p. 248.
(14) Ibid.
(15) La Route des Flandres, op. cit., p. 296.
(16) Philippe Bonnefis, « Le fantôme du kiosque », in Claude Simon, La Route des Flandres, Littératures contemporaines, 3, Paris, Klincksieck, 1997, p. 89.
(17) Bis repetita, La répétition à l’œuvre, op. cit., p. 99.
(18) Histoire, op. cit., p. 263.
(19) La Route des Flandres, op. cit., p. 28 et Histoire, op. cit., p. 368.
(20) Les Géorgiques, op. cit., p. 214.
(21) La Route des Flandres, op. cit., p. 126.
(22) Maurice Blanchot, L’Entretien infini, op. cit., pp. 35-36.
(23) Le Vent, op. cit., p. 240-241.
(24) Picon évoque cette circularité métaphoriquement dans Lecture de Proust, op. cit., p. 27 : « Dans l’œuvre, le flux de la vie n’avance que sur les eaux du reflux ».
(25) Antoine Compagnon, préface du côté de chez Swann, op. cit., p. 25.
(26) Correspondance générale, Paris, Plon, 1930-1936, t. III, p. 72.
(27) Du côté de chez Swann, op. cit., p. 35.
(28) Article paru initialement en 1988 dans Art Press, puis dans Le Voyageur, op. cit., p. 490.
(29) Ibid.
(30) Antoine Compagnon, Proust entre deux siècles, op. cit., p. 49.
(31) Michel Raimond, La Crise du Roman, op. cit., p. 168.
(32) Le Temps retrouvé, op. cit., p. 980. Le même spectacle se produit pour la rencontre avec Charlus dans A l’ombre des jeunes filles en fleurs, t. I, p. 451 : « J’aperçus un homme grand et gros, (…). J’étais certain en tout cas que je ne connaissais pas le promeneur (…) c’était M. de Charlus ».
(33) Le Temps retrouvé, op. cit., t. III, p. 1048.
(34) Samuel Beckett, Proust, op. cit., p. 23.
(35) Alain Robbe-Grillet, Projet pour une révolution à New York, Paris, Minuit, 1970, p. 7.
(36) Jean Ricardou, Pour une théorie du Nouveau Roman, Paris, Seuil, 1971, p. 212.
(37) Gaïtan Picon, Lecture de Proust, op. cit., p. 150.
(38) Claude Simon, La Route des Flandres, Paris, Minuit, 1997, p. 296.
(39) Le Temps retrouvé, op. cit., p. 609.
(40) Le Temps retrouvé, op. cit., p. 615.
(41) Le temps proustien est ambivalent, il mène au vieillissement mais apporte une évolution à l’expérience ; à ce propos Beckett constate : « ce monstre bicéphale de damnation et de salut ».Proust, op. cit., p. 21.
(42) Le Miroir qui revient, Paris, Minuit, 1984, p. 227.
Sophia Dachraoui
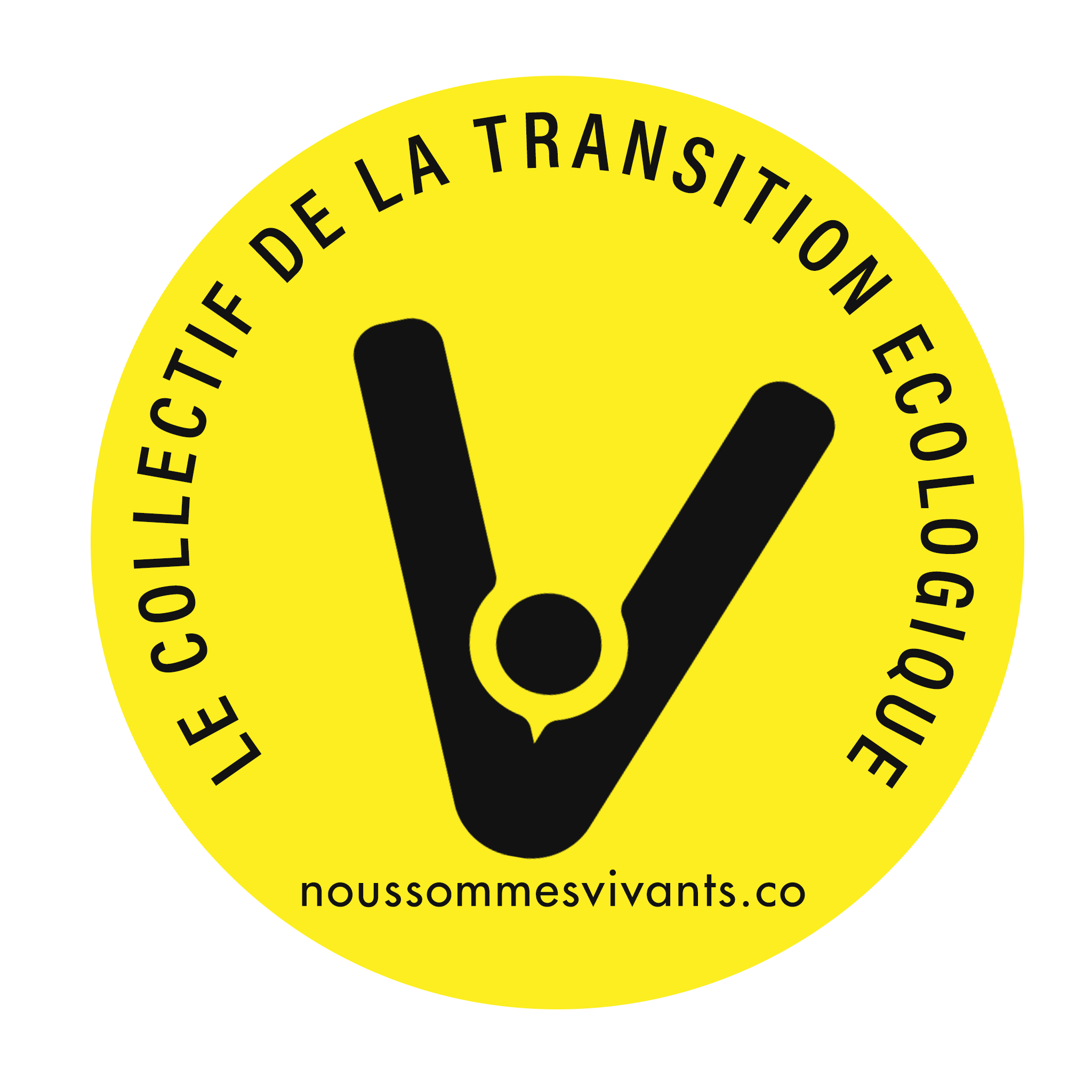
Laisser un commentaire