Plan de l'article
- La déviance économique, depuis l’anomie jusqu’aux affaires
- Enquêter sur la déviance économique
- La désignation de la déviance
- Déviance et redressement
Affaires de corruption, scandales financiers, catastrophes sanitaires, désastres écologiques, beaucoup de situations ont donné lieu, ces dernières années, à la mise en cause d’entreprises, de leurs patrons et/ou de certains de leurs employés. L’affaire Kerviel, la crise du Médiator ou encore le scandale des prothèses PIP comptent ainsi parmi les cas les plus médiatiques de mises en accusation récentes d’entreprises. Par ailleurs, sans donner lieu à une telle couverture médiatique, bien d’autres pratiques engendrent régulièrement des litiges plus locaux, à l’échelle d’un secteur industriel, d’une société, ou même d’un service (optimisation fiscale, corruption, travail « en perruque »…). Il est bien là aussi affaire d’« affaires ».
Affaire, le mot est riche puisqu’il sert à désigner une « entreprise commerciale ou industrielle » et, au pluriel, « les activités économiques (notamment dans leurs conséquences commerciales et financières) » tout aussi bien qu’une situation « qui occupe de façon embarrassante, qui est difficile ou compliquée », voire qui a trait « au scandale social, politique venant à la connaissance du public » [1][1] « Affaire », définition in Le Petit Robert de la langue…. Sans considération de son histoire, cette polysémie du terme « affaire » permet de résumer le projet de ce numéro thématique de terrains & travaux : étudier des affaires (au sens de situations embarrassantes pouvant aller jusqu’au procès) concernant des affaires (au sens d’entreprises et d’activités économiques).
Au-delà de cette première façon de présenter le numéro, son titre lui-même permet de préciser le double cadrage auquel nous avons procédé. D’abord, en abordant le thème d’« entreprises et déviance », il s’agissait d’embrasser à la fois l’étude de la déviance des entreprises (en tant que personnes morales) et celle de la déviance en entreprise (notamment par des personnes physiques qui y travaillent) [2][2] On trouve ici une distinction dont l’anglais rend également…. Ensuite, en préférant le terme de « déviance » à celui de « délinquance » (et la thématique de la « délinquance économique »), il s’agissait d’inclure dans notre objet d’étude, non seulement les actes dénoncés dans le cadre de procédures judiciaires, mais aussi tous les comportements stigmatisés au nom de normes échappant à une définition juridique.
La déviance économique, depuis l’anomie jusqu’aux affaires
Sans sacrifier à quelque obligation de remonter aux pères fondateurs, on ne saurait aborder la question des normes dans le monde économique sans rappeler que Durkheim l’a lui-même posée et traitée. Il écrivait ainsi dans la préface à la seconde édition de la Division du travail social :
« Nous insistons à plusieurs reprises, au cours du livre, sur l’état d’anomie juridique et morale où se trouve actuellement la vie économique. Dans cet ordre de fonctions, en effet, la morale professionnelle n’existe véritablement qu’à l’état rudimentaire. Il y a une morale professionnelle de l’avocat et du magistrat, du soldat et du professeur, du médecin et du prêtre, etc. Mais si l’on essayait de fixer en un langage un peu défini les idées en cours sur ce que doivent être les rapports de l’employeur avec l’employé, de l’ouvrier avec le chef d’entreprise, des industriels concurrents les uns avec les autres ou avec le public, quelles formules indécises on obtiendrait ! Quelques généralités sans précision sur la fidélité et le dévouement que les salariés de toutes sortes doivent à ceux qui les emploient, sur la modération avec laquelle ces derniers doivent user de leur prépondérance économique, une certaine réprobation pour toute concurrence trop ouvertement déloyale, pour toute exploitation par trop criante du consommateur, voilà à peu près tout ce que contient la conscience morale de ces professions ».
(Durkheim, 1893 [seconde préface adjointe à la deuxième édition en 1902], p. ii)
La première conclusion tirée de l’étude de la régulation des comportements dans le monde de l’entreprise a donc été un constat d’anomie. Et pour Durkheim, non seulement les règles sont floues, mais les prescriptions adressées aux acteurs économiques sont également « dénuées de tout caractère juridique ; elles ne sont sanctionnées que par l’opinion, non par la loi, et l’on sait combien l’opinion se montre indulgente pour la manière dont ces vagues obligations sont remplies » (ibid.). Quelle qu’ait pu être la validité empirique de la conclusion d’É. Durkheim en son temps, nous ne pouvons reprendre telle quelle l’affirmation d’une « anomie juridique et morale » de la vie économique. Nous pouvons en revanche nous interroger sur la spécificité de la formation et de l’imposition des normes concernant les pratiques économiques.
C’est d’ailleurs sur l’impunité des délinquants d’affaires qu’E. Sutherland a poursuivi la réflexion sociologique sur la régulation des comportements économiques, s’attachant à démontrer et à expliquer le traitement plus indulgent de la « criminalité en col blanc » que de la « criminalité ordinaire ». À l’image de la thèse défendue dans son article « Crime and Business », traduit dans ce numéro, l’ensemble de l’œuvre de Sutherland poursuit un double projet : dénoncer l’assimilation réductrice de toute délinquance à un comportement propre aux classes défavorisées, et mettre en évidence les facteurs (parmi lesquels le travail de lobbying des criminels en col blanc) qui conduisent à la faible sanction de comportements non conformes aux règles en vigueur. Comme le souligne P. Lascoumes (1985, 1986), l’approche de Sutherland comporte encore une dimension fonctionnaliste héritière des réflexions en termes d’ « anomie » ou de « désorganisation sociale », mais elle comporte surtout une dimension culturaliste inédite. Sutherland montre ainsi que c’est dans un groupe que se développe la personnalité du criminel. Les normes morales en vigueur dans chaque sous-culture déterminent ainsi l’attitude devant les « infractions ». Ces normes peuvent, par exemple, n’indiquer aucune désapprobation vis-à-vis de certains vols considérés au contraire comme une activité normale. E. Sutherland préfigure ainsi la « théorie de l’étiquetage » développée plus tard au sein de l’École de Chicago, notamment autour des notions de « sous-culture » et de « carrière déviante ». Pour les sociologues interactionnistes de Chicago, les normes sont en effet locales, plurielles, contradictoires, de telle sorte que « la déviance est une propriété non du comportement lui-même, mais de l’interaction entre la personne qui commet l’acte et celles qui réagissent à cet acte. » (Becker, 1963, p. 35) Tout l’enjeu pour le sociologue est d’observer à quelles conditions un individu en vient à être désigné comme déviant, et comment ceux que l’on appelle « entrepreneurs de morale » s’attachent à construire et imposer de nouvelles normes. Plus large que le cadre de Sutherland, la sociologie interactionniste offre une grille de lecture puissante pour aborder la déviance des entreprises et la déviance en entreprise. C’est dans cette perspective qu’a été construit ce numéro.
Rebouclons pour finir sur les « affaires ». Tout étiquetage ne donne pas lieu à une affaire, ou pour le dire de façon plus générique, à un litige. Il n’empêche que, si l’interactionnisme symbolique s’est attaché à mettre en évidence les conditions conduisant à un procédé d’étiquetage, l’apport de la sociologie pragmatique « de la critique » (Boltanski, 1990, 2009) et « des épreuves » (Blic et Lemieux, 2005 ; Lemieux, 2007) a été de compléter l’étude du processus en montrant combien un étiquetage peut produire des contestations qui, lorsqu’elles dépassent le cadre de l’interaction locale, peuvent engendrer affaires et scandales. Cette sociologie des litiges a ainsi suscité de nombreuses études de cas, depuis l’affaire Calas (Claverie, 1994) jusqu’au scandale du Crédit Lyonnais (Blic, 2000) et depuis le procès de Socrate jusqu’aux poursuites contre Pinochet (Offenstadt et Van Damme, 2007). C’est avec le même souci d’étudier la carrière et les effets de la critique publique que ce numéro a été élaboré.
Dans cette perspective, l’étude de la « déviance économique » peut être adossée à trois questions : Qu’est-ce qui conduit à la désignation d’un acte comme « déviant » ? À quels outils de pression est adossée la dénonciation ? Quelles réactions la dénonciation produit-elle ? On rejoint alors le projet de Felstiner et al. (1980-1981) d’étudier les litiges comme le fruit d’une série de « transformations », d’une « expérience offensante inaperçue » en « expérience offensante perçue » (« naming »), de l’expérience offensante perçue en « grief » imputable à la faute d’une personne ou d’une entité (« blaming »), grief qui se mue enfin en « réclamation » auprès de l’entité désignée responsable (« claiming »), puis en « litige » si cette réclamation n’est pas reconnue comme légitime.
Dans ce cadre, et avec pour seule exigence d’examiner des conflits impliquant des entreprises, nous avons laissé ouvert le périmètre des entités impliquées (qu’il s’agisse de celles qui dénoncent ou de celles qui sont dénoncées), des dommages perçus, des normes mobilisées, des sanctions exercées, et des contestations suscitées. Le numéro réunit donc des situations variées.
D’abord, les études de cas portent sur des entreprises très différentes du point de vue de leur taille, de leur notoriété et de leur secteur d’activité : La Poste, Metaleurop, Monsanto, la MNEF, pour les plus grosses, mais aussi un éditeur de jeu vidéo, des sociétés de portage, des artisans d’art et une petite boutique de matériel pour graffeurs. Ensuite, du point de vue de la répartition des rôles, tantôt c’est l’entreprise comme personne morale qui dénonce (lorsque La Poste s’attache à qualifier les fraudes de ses agents pour les sanctionner), tantôt c’est elle qui est dénoncée (quand l’exploitant agricole Paul François pointe la responsabilité de Monsanto dans la dégradation de son état de santé). Les griefs sont eux aussi variés : des dirigeants sont critiqués pour leur engagement dans des pratiques frauduleuses (C. Argibay) ou jugées irresponsables (O. Mazade), des entrepreneurs sont accusés d’offrir un service aux marges de la légalité (F. Darbus), une entreprise est accusée d’avoir commercialisé un produit toxique pour ses usagers (J.-N. Jouzel et G. Prete), des artisans transgressent les normes professionnelles (A. Jourdain), des micro-organisations sont accusées de concurrence déloyale (B. Vétel), des salariés de La Poste transgressent les règlements de leur entreprise (N. Vezinat), une clientèle de bombes de peinture est accusée de faire un usage « vandale » des produits vendus pourtant en toute légalité (Y. Gicquel). Enfin, les litiges observés prennent des formes diverses. Affectant parfois des systèmes locaux de régulation (celui d’une entreprise, d’une activité professionnelle ou d’un marché précis), ils peuvent aussi se muer en « affaires » ou « scandales » [3][3] La distinction entre « scandale » et « affaire » renvoie… (Metaleurop, MNEF…) dont l’ampleur oblige à se réinterroger plus généralement sur les valeurs morales et les normes juridiques sur lesquelles s’appuient ou, au contraire, devraient s’appuyer les activités économiques.
Ces cas variés viennent nourrir une réflexion que nous souhaitons ici articuler autour de quatre questionnements, dont un méthodologique : Comment enquêter sur la déviance économique ? Quelles sont les conditions de la désignation d’un comportement déviant ? Quelles formes prend la sanction des comportements déviants ? Où conduisent la désignation et la sanction des comportements déviants ?
Enquêter sur la déviance économique
L’apprentissage puis la routinisation d’un comportement déviant, de même que les procédés et les acteurs de l’étiquetage et de la dénonciation, sont pour la sociologie de la déviance, des étapes importantes de la description du phénomène mais constituent parfois une gageure méthodologique. Dans ce numéro, nous avons réuni des textes dont les dispositifs méthodologiques varient grandement, d’une part selon qu’il s’agit de décrire le comportement désigné comme « déviant » ou d’examiner plutôt la démarche de ceux qui procèdent à cet étiquetage ; d’autre part selon qu’il s’agit d’observer la déviance (et son étiquetage) « en action », ou de reconstruire des litiges anciens à partir d’un matériau archivistique, éventuellement complété d’entretiens rétrospectifs.
D’abord, il est complexe d’observer la déviance du côté des transgresseurs. L’observation de la déviance « en action » requiert du chercheur une immersion sur le terrain suffisante pour que les acteurs lui fassent confiance et ne craignent pas un risque de sanction si leurs pratiques venaient à être révélées par la diffusion des résultats de l’enquête (Sachet-Milliat, 2009). Cette difficulté est soulevée très tôt par la sociologie américaine, notamment W. F. Whyte quand il fait l’ethnographie des bandes de jeunes immigrés italiens d’un quartier de Boston, dont il intègre les rangs dans les années 1930 et observe les divers commerces, notamment le « racket » via l’organisation de paris sur des courses de chevaux. Plus récemment, S. Venkatesh, en réalisant l’ethnographie dans les années 1990 du gang des Black Kings à Chicago, a été amené à reconstituer l’économie informelle qui a cours dans ces quartiers (trafic de drogue, prostitution mais aussi couture à domicile, échange de petits services etc.) en marge de la légalité mais assurant le maintien d’un ordre économique et social à l’abri du regard des autorités officielles (Venkatesh, 2006, 2009). L’analyse de l’économie informelle (Fontaine et Weber, 2010) par le biais d’une approche ethnographique produit des contraintes de terrain que l’on retrouve dans les études sur la déviance d’entreprise, à commencer par la question de l’accès au terrain et le point de vue qui en découlera.
Analyser la « déviance en action » impose en effet au chercheur de choisir les « bons » points d’entrée sur le terrain. Par exemple, entrer par la voie hiérarchique constitue une sérieuse entrave à l’étude des pratiques irrégulières des salariés (Bonnet, 2008). Ensuite, dissimuler son statut d’observateur, comme le fait Becker au début de son enquête sur les fumeurs de marijuana, peut s’avérer utile ; mais au-delà des enjeux éthiques, c’est là une façon de faire bien périlleuse si elle est découverte. Enfin, une fois le mode d’accès au terrain résolu, demeure la question de la censure que peuvent s’imposer les acteurs quand il s’agit d’évoquer les petites transgressions qu’eux ou leurs collègues ont pu commettre au travail (Anteby, 2003). Ainsi, C. Argibay retrace les origines des pratiques transgressives à la MNEF en dépouillant des archives de l’entreprise, de façon à les confronter ensuite aux discours des acteurs alors impliqués dans les dérives affairistes de la Mutuelle. Difficile cependant de mener un terrain sur un scandale encore frais, quand la seule mention de la MNEF disparaît dans les CV et que le silence ou la dénonciation des uns et des autres finit par complexifier l’analyse des pratiques vécues en amont.
Outre la démarche ethnographique, le récit de vie peut constituer une méthode riche pour analyser les trajectoires de déviance. Mobilisée par Thrasher (1927), Shaw (1930) ou Sutherland (1937) lorsqu’ils retracent l’histoire de gangs ou de petits délinquants à Chicago, cette méthode fait également partie des recommandations édictées par Sutherland à propos des criminels en col blanc dans son article « Crime and Business » (voir notre traduction) : invitant à recueillir des confessions, sous forme de témoignages, il s’agit de comprendre les motifs et les modes opératoires de cette délinquance particulière.
En prenant le point de vue d’un dénonciateur, J.-N Jouzel et G. Prete mobilisent eux aussi la méthode biographique, grâce à des entretiens approfondis auprès d’un acteur privilégié, celui-là même qui a accusé une entreprise de produits chimiques d’être responsable de ses troubles de santé. À distance des événements, les carrières de ces acteurs, qu’ils soient déviants ou victimes, se présentent comme des histoires exemplaires, les éléments essentiels d’une « mosaïque scientifique » pour reprendre les termes de Becker, à visée plus générale : « même si la biographie ne fournit pas, par elle-même, de preuve décisive en faveur d’une hypothèse, elle peut être un cas négatif qui nous oblige à déclarer inadéquate la théorie proposée » (Becker, 1986, p. 107). Le parcours de Paul François en tant que victime, par sa singularité même, permet ainsi de mieux comprendre « ce qui a pu l’amener à s’engager dans une action collective inédite en France, celle des travailleurs agricoles victimes des pesticides » (J.-N Jouzel et G. Prete).
Toujours du côté des entrepreneurs de morale, s’il s’agit non pas d’étudier une situation « chaude » mais les traces « refroidies » de jugements antérieurs, le recours aux archives comme alternative aux entretiens peut s’avérer utile. Ainsi, quand N. Vezinat étudie la réaction de La Poste face aux fraudes commises par ses salariés, ce sont les documents internes à l’entreprise qui lui permettent d’analyser les divers cas mis en cause, dénoncés et sanctionnés en interne.
Prendre de la distance temporelle avec les événements n’est cependant pas exempt de difficultés, comme O. Mazade le montre quand il cherche à comprendre « une dénonciation impossible » à propos de l’entreprise Metaleurop, dont l’actionnaire de référence est parvenu à démanteler l’usine sans pouvoir être arrêté à temps. Privilégiant le point de vue des salariés de l’entreprise – i.e. ceux-là mêmes qui dénoncent aujourd’hui, mais trop tard, ces pratiques malhonnêtes – l’auteur les invite à revenir sur certaines anomalies de fonctionnement qu’ils avaient alors pu observer au moment où l’usine fonctionnait, en soulignant leur difficile décryptage. Ainsi, la reconstruction ex post révèle des signaux faibles qu’une étude sur le vif n’aurait pas permis d’isoler comme des comportements déviants – puisque personne à l’époque ne les étiquetait ainsi – en contournant l’écueil de l’analyse anachronique voire téléologique, toujours saillant quand il s’agit de reconstituer la complexité d’une histoire dont on connaît la fin.
Notons pour finir que l’analyse de la déviance d’entreprise présente la contrainte de mettre parfois le chercheur dans une situation complexe où l’observation des pratiques déviantes, si elle peut flatter son goût du risque et le sentiment d’intégrer un groupe fermé et sélectif (Whyte, 1955 [4][4] Les difficultés de terrain rencontrées par W. F. Whyte… ; Venkatesh, 2009), peut aussi mener à des cas de conscience quand les actes en question heurtent sa sensibilité et son sens de la déontologie (Cefaï et Costey, 2009). Ce qu’on peut dire ou ne pas dire demeure pour le sociologue un casse-tête assez classique, mais dans le cas de la déviance d’entreprise, l’organisation du travail ou du secteur peut se voir perturbée par des analyses dévoilant des actes de déviance. Ne pas trahir la confiance d’un informateur, tout comme rendre impossible l’identification des déviants en décrivant leurs pratiques incriminables par le droit ou des sanctions internes, constituent des prudences méthodologiques essentielles. C’est pourquoi Y. Gicquel comme B. Vétel ont eu le souci de masquer les lieux et les auteurs des transgressions observées pour protéger leurs enquêtés et, de façon concomitante, préserver leur capacité à pouvoir continuer leur enquête.
Mais une ultime question méthodologique concerne la posture générale que prend le chercheur face à ce type d’objet sensible. Évoquant l’étude des scandales, D. de Blic et C. Lemieux (2005) formulent à cet égard quelques précautions à destination du chercheur, en soulignant que la neutralité axiologique n’est ni soluble dans l’objectivisme – qui tend à nier la réaction même des acteurs du scandale et à prendre parti en prétendant ne pas le faire – ni dans le « réductionnisme stratégique » – qui survalorise l’intérêt à dénoncer de ceux qui souhaiteraient, par ce biais, en tirer de la visibilité. Sans s’indigner ou balayer d’un revers de main l’objet même du scandale, les auteurs défendent le « principe de symétrie » visant à mettre à égalité les acteurs et les arguments. Il nous semble que c’est dans ce sens que les auteurs du numéro ont pensé leur contribution, que ce soit en donnant à entendre les divers acteurs par le biais d’extraits d’entretiens, ou en reconstruisant à partir d’une analyse documentaire et archivistique les points de vue défendus par les uns et les autres au moment des litiges.
La désignation de la déviance
« En règle générale, pour faire respecter les normes, il faut que quelque chose déclenche le processus » (Becker, 1963, p. 145). Le premier aspect examiné par la plupart des auteurs du numéro concerne précisément la genèse de la dénonciation, abordée à travers deux enjeux : Quel est l’élément déclencheur du processus ? Quelles normes s’emploie-t-on à faire respecter ?
L’engagement dans la dénonciation
Comme l’a souligné H. Becker, les « entrepreneurs de morale » doivent avoir une motivation à agir, sans quoi l’étiquetage n’a pas lieu de survenir. L’activation d’une norme est ainsi souvent le fait de personnes qui ont un intérêt à la défendre, comme dans l’exemple qu’il emprunte à Malinowski : un jeune Trobriandais avait commis un inceste clanique et bien que tout le monde fût au courant personne n’était intervenu ; mais le jour où le prétendant de la jeune fille mobilisa cette norme pour, finalement, sanctionner un homme dont il était jaloux, toute la communauté reconnut que l’inceste clanique était une faute qui devait être punie. La dénonciation d’un acte non-conforme est bien le résultat d’un processus. Et il n’est pas question ici de distinguer la sanction judiciaire des autres formes de sanctions ; si les règles de droit sont certes stabilisées, la poursuite effective des auteurs d’une infraction nécessite un repérage et un signalement, lesquels n’ont rien d’automatique.
L’existence d’un dommage est souvent un moteur de dénonciation. Lorsqu’une « crise morale » est ouverte (Dodier, 1995), lorsqu’une « expérience offensante » est perçue (Felstiner et al., 1980-1981), cela conduit le plus souvent à la quête d’un « responsable » dont on s’attache à démontrer la défaillance du comportement. Inversement, il est plus d’un cas où une situation finalement jugée déviante a pu longtemps rester impunie du fait même qu’un dommage n’avait pas encore été perçu ou anticipé. C’est ainsi que ni les syndicats, ni les salariés, ni les autorités locales n’ont su ou voulu reconnaître dans l’évolution de l’usine Metaleurop Nord une situation de prédation digne d’être dénoncée, faute de signaux suffisants et facilement interprétables en termes de risque pour la pérennité des emplois (O. Mazade). Pour que la dénonciation ait lieu, des signaux doivent pouvoir être reconnus et interprétés par des « lanceurs d’alerte » (Chateauraynaud et Torny, 1999) qui se chargeront de les convertir en preuves de déviation à un système de normes imposables aux déviants. C’est ainsi que Paul François (J.-N. Jouzel et G. Prete) réalise un long chemin pour percevoir dans sa maladie les symptômes de maux causés par Monsanto et faire ensuite reconnaître ces signes comme un préjudice valant réparation.
Un autre moteur de la dénonciation publique peut être le souci de montrer son attachement aux normes en vigueur : en critiquant le déviant, on réaffirme publiquement son propre respect des normes. C’est très exactement ce qui se joue dans l’article d’A. Jourdain où, faisant suite à la médiatisation d’une pratique non-conforme (un artisan d’art dont une partie de la production est sous-traitée en Asie et en Europe de l’Est), les promoteurs de l’artisanat d’art entreprennent de repositionner publiquement les frontières de leur secteur (par rapport à l’industrie). S’il y a peut-être une volonté d’évincer un concurrent déloyal, c’est assurément l’image de la profession que ces instances entendent plus largement protéger. C’est aussi ce qui ressort de l’article de Y. Gicquel, lorsque le gestionnaire de la boutique de matériel fréquentée par des graffeurs placarde sur sa vitrine une affiche rappelant l’interdiction de « tagguer ou réaliser des dégradations » dans les rues du quartier. Dans ce cas, la condamnation formelle de pratiques que les riverains jugent déviantes (car génératrices de dommages) vise certes peut-être à endiguer ces comportements, mais elle est au moins autant un moyen pour le vendeur de se prémunir du courroux de ses voisins.
Le référentiel normatif support de la dénonciation
La justification de l’étiquetage se fait toujours au nom d’un référentiel normatif, qui peut être institué de différentes façons, et par des acteurs variés. Dans le cas d’A. Jourdain, c’est « l’éthique professionnelle » des artisans d’art qui est mobilisée pour dénoncer des pratiques de production « dégradées » – laquelle éthique se traduit dans un socle commun de conventions, mais aussi dans des normes propres aux différentes communautés professionnelles qui composent l’artisanat d’art. Dans le cas de F. Darbus, le débat qui porte sur la légalité du portage salarial a d’abord le droit comme référentiel normatif – employer des travailleurs indépendants pour leur fournir un statut de salarié est-il conforme au droit du travail interdisant le commerce de main-d’œuvre ? – mais mobilise tout aussi bien des arguments pragmatiques et moraux sur les formes « acceptables » (i.e. non « monstrueuses ») d’entreprises qui pourraient malgré leur licéité contestée s’adonner à ce type d’activité.
Ainsi, une fois identifiés, il s’avère aussi intéressant d’analyser les modes de coexistence de ces référentiels normatifs. Par exemple, certaines routines d’entreprise s’éloignent de ce qui est juridiquement permis tout en faisant l’objet d’une tolérance généralisée comme pour le travail en perruque observé par M. Anteby (2003), ou le vol en interne analysé par F. Bonnet (2008). Si le vol est connu des directions, ces dernières recourent rarement aux tribunaux mais à une surveillance qui fait figure d’outil de pression managériale aux dépens de salariés qui, s’ils sont pris, connaîtront des sanctions non pas judiciaires mais disciplinaires (licenciement pour faute grave). Cette coexistence mérite dans tous les cas d’être observée du point de vue des acteurs : comment, par exemple, les militants de l’UNEF percevaient-ils la rétribution de certaines activités militantes sur les fonds de la MNEF dans les années 1970 ? Avec bienveillance nous explique C. Argibay, ces petits arrangements financiers étant pensés comme le fonctionnement normal et nécessaire du militantisme politique, par ailleurs au fondement de la création de la Sécurité sociale étudiante. La déviance n’apparaît que lorsque le détournement de fonds change d’échelle et vient récompenser l’appât du gain de certains individus au détriment de l’intérêt général. La dénonciation qui se mue ensuite en scandale fournit une double étiquette aux transgresseurs : ils sont délinquants car leur comportement est désormais incriminé par le droit pénal mais ils sont aussi déviants par rapport à des normes économiques, morales et politiques de probité, d’intégrité et de transparence qui se réaffirmeront d’ailleurs à l’issue du scandale (Blic, 2005).
Déviance et redressement
Le deuxième aspect examiné dans les articles est la dimension régulatrice des processus d’étiquetage. La question de la régulation se décline alors en deux enjeux : celui des modalités de la sanction des pratiques défaillantes d’une part, et celui des effets que l’activation des normes produit non seulement sur l’accusé mais aussi sur l’accusateur et en définitive sur une communauté dans son ensemble.
La sanction de la déviance
Être désigné comme déviant est, en soi, déjà une sanction – sauf pour ceux qui, pleinement entrés dans une carrière déviante, y sont indifférents voire, dans une logique d’inversion du stigmate, en sont fiers. Car le simple fait de montrer du doigt produit une « stigmatisation » qui, si l’on veut bien retourner à l’origine étymologique du terme, est assurément un marquage punitif. Comme le soulignait déjà É. Durkheim « si je ne me soumets pas aux conventions du monde, si, en m’habillant, je ne tiens aucun compte des usages suivis dans mon pays et dans ma classe, le rire que je provoque, l’éloignement où l’on me tient, produisent, quoique d’une manière plus atténuée, les mêmes effets qu’une peine proprement dite. » (Durkheim, 1895, pp. 4-5). Mais au-delà de la peine infligée par la seule désignation d’un acte comme déviant, il n’est pas rare que les entrepreneurs de morale s’attèlent explicitement à (faire) châtier les déviants pour les « redresser », suivant la formule d’A. Hirschman. Celui-ci précisait :
« Dans la vie de toute société, on rencontre une certaine proportion de comportements déviants ou dysfonctionnels [qu’il s’agisse d’individus, d’entreprises ou d’organisations]. Pour que ces derniers, par leurs effets cumulés, n’entraînent pas un déclin général, la société doit rassembler ses forces pour ramener le plus grand nombre possible de ses membres défaillants à des comportements compatibles avec son fonctionnement normal ».
(Hirschman, 1970, p. 1)
Les propos d’A. Hirschman ont clairement un écho fonctionnaliste, soutenant qu’il y a un « fonctionnement normal » de la société et que tout comportement « dysfonctionnel » active automatiquement des forces correctrices. Mais même avec une définition interactionniste de la déviance, la question se pose : comment les entrepreneurs de morale procèdent-ils lorsqu’ils entendent redresser les déviants ?
D’abord, pour reprendre une distinction canonique, on peut identifier deux modes de sanction des entités déviantes : la sanction « organisée » (i.e. rendue par un corps constitué, tel un tribunal), et la sanction « diffuse » (Durkheim, 1893 ; Ogien 1990).
Pour recourir au droit, il faut être en mesure d’inscrire la dénonciation dans les termes des textes juridiques, et s’en remettre ensuite à la sentence prononcée par un organe dédié. Nous avons indiqué plus haut que la poursuite effective des auteurs d’une infraction nécessite un repérage et un signalement, lesquels n’ont rien d’automatique. Nous pouvons ajouter ici que la sanction est aussi le fruit de l’appréciation du juge. C’est bien ce qui conduit E. Sutherland à écrire : « L’absence relative de condamnations pénales n’est nullement la preuve que ce type de comportement n’est pas criminel. » (Sutherland, 1941, p. 114). On pourra être surpris par la formule : au nom de quoi le chercheur peut-il désigner comme « criminel » un comportement auquel les juges ont dénié cette qualification ? À tout le moins peut-on souligner que tout jugement peut être contesté, ce qui conduit notamment Sutherland à parler d’une « indulgence » des juges « en raison d’affinités personnelles et d’une certaine bienveillance à l’égard des pratiques des criminels en col blanc, mais aussi en raison d’une jurisprudence habilement construite par les brillants avocats de ces criminels » (idem).
Un bel exemple de « sanctions organisées » (par une autorité disciplinaire) nous est donné par N. Vezinat à travers le système de sanctions imposées par La Poste aux salariés coupables de malversations, qui emprunte à divers registres : des peines purement disciplinaires (blâme, avertissement), des formes de pénalisation financière (radiation du tableau d’avancement, privation d’une partie du salaire pour les contractuels), des mesures d’éviction de l’entreprise, soit temporaires (mise à pied), soit définitives (révocation ou licenciement). Sans recourir à la procédure judiciaire, l’entreprise comme toute organisation, produit ainsi un système de redressement des torts capable d’affirmer en creux l’ordre moral et professionnel qu’elle entend sauvegarder.
Si dans le cas de la MNEF, de Metaleurop ou de la société de jeux décrite par B. Vétel, le droit est mobilisé dans le cadre de procédures judiciaires, nous trouvons aussi dans les articles réunis ici, diverses formes de « sanctions diffuses », à commencer par l’éviction d’une communauté professionnelle. Ainsi, A. Jourdain, qui consacre une partie entière de son article aux efforts de « régulation » des promoteurs de l’artisanat d’art, met bien en évidence l’exercice d’actions coercitives qui ne relèvent en aucun cas d’un jugement de droit. Dans une démarche proche de celle d’A. Hirschman (1970) lorsqu’il examinait la régulation de la qualité par les démarches de « défection » et de « prise de parole », elle montre comment un artisan a été contraint de changer ses pratiques lorsqu’il a perçu un désaveu de la clientèle (qui tout simplement n’achète plus), et comment un autre est au contraire parvenu à maintenir ses pratiques en dépit de leur dénonciation publique par des instances professionnelles – lesquelles ont bien tenté, par ailleurs, de recourir au droit, mais en vain.
Cette distinction étant faite, entre les sanctions organisées par le droit et celles qui sont appliquées de façon diffuse, il convient de souligner l’existence d’une troisième voie de gestion des « défaillances ». Il peut en effet arriver que, face à une situation non conforme aux attentes, à une « irrégularité », la réaction ne se traduise pas par la stigmatisation d’une entité qualifiée de « déviante » mais plutôt par une mise en lumière, et en cause, des conditions de possibilité de la défaillance. C’est ce que suggère N. Dodier (1995) lorsque, s’intéressant aux incidents de production, il différencie l’attitude accusatoire « qui vise à chercher les responsables de l’incident, pour les sanctionner » et l’attitude fonctionnelle « qui vise à se saisir de l’incident pour améliorer à l’avenir le fonctionnement du réseau, notamment en ce qui concerne sa sécurité » [p. 139]. Il prend pour exemple la méthode de l’arbre des causes, qui consiste à recenser les antécédents de l’incident, sans considération de la désignation d’un coupable. C’est ainsi par exemple que, constatant l’occurrence d’erreurs dans l’activité des jeunes agents, La Poste y a vu un défaut de formation et a pris des mesures dans ce sens. D’une certaine manière, le recrutement d’assistants sociaux pour endiguer les malversations d’agents en grandes difficultés financières peut également être vu comme une réponse fonctionnelle à des comportements frauduleux.
Comme on le voit, le temps de la sanction est aussi celui de la requalification des comportements. C’est particulièrement patent dans l’article sur l’attitude de La Poste face aux malversations de ses agents, mais ça l’est aussi dans celui de B. Vétel sur la réaction d’une entreprise créatrice de jeux vidéo confrontée au déploiement de serveurs privés. Les deux articles mettent en évidence la façon dont l’entité « victime » en vient à distinguer dans le vaste groupe des comportements identifiés comme déviants par rapport à une norme principale (des salariés qui commettent des irrégularités, des serveurs dupliquant illégalement un jeu officiel), un groupe de comportements devant être sanctionnés et un groupe de comportements pouvant ne pas l’être (ce qui n’est pas équivalent à « ne devant pas l’être »). Dans le cas des serveurs de jeux vidéo, la catégorisation des déviants se fait sur la base d’une double bipartition : lucratifs ou non d’une part, faiblement ou fortement fréquentés d’autre part. À cette catégorisation correspond ensuite un système de mesures d’incrimination jugées proportionnelles au niveau du préjudice ressenti par l’entreprise. Dans le cas de La Poste, on observe également une double bipartition suivant l’intentionnalité d’une part, et suivant les circonstances atténuantes ou aggravantes d’autre part (notamment la récidive ou non, la reconnaissance ou le déni du caractère répréhensible du comportement). Mais au-delà du processus de désignation localisé visant à sanctionner individuellement une entreprise, un salarié ou un concurrent se joue aussi parfois un débat plus général sur les normes et les valeurs qu’une communauté souhaite, à l’occasion du litige, réaffirmer pour renforcer sa cohésion.
La force institutante du litige
Certaines démarches de dénonciation ont pour objectif manifeste de « faire une affaire » pour réaffirmer un attachement à certaines normes (sans considération majeure de l’effet sur celui qui est dénoncé), d’autres démarches ont pour objectif premier de « redresser les déviants » (sans considération majeure de l’effet sur les autres). Au bout du compte, toutes les entreprises d’étiquetage ont à la fois des effets sur celui qui est dénoncé, sur celui qui dénonce et sur les témoins de la dénonciation. C’est ce que soulignent D. de Blic et C. Lemieux (2005) en évoquant, en écho aux travaux de l’anthropologie fonctionnaliste, la « force instituante » des épreuves que constituent les affaires et les scandales. Loin de n’être que le révélateur d’un état de fait, l’épreuve transforme ce qu’elle entend mesurer/qualifier. Reprenant les travaux de l’anthropologue M. Gluckman, ils notent : « le scandale est l’une des principales activités à travers lesquelles des groupes se redessinent, des hiérarchies se défont, et des appartenances s’instituent » (Blic et Lemieux, 2005, p. 14). En même temps que les individus dénoncent, médisent, montrent du doigt leurs semblables, se joue aussi un renforcement de la cohésion sociale du groupe et la réaffirmation de ses frontières. Y. Gicquel ne parle pas d’autre chose quand il décrit les différents collectifs de graffeurs présents dans la boutique de bombes de peinture qu’il observe : les pratiques des membres old school (les anciens) sont valorisées en partie pour leur technique de réalisation mais aussi dans les normes que ces membres véhiculent. La valeur de « respect » qui consiste à ne pas « repasser » sur des murs déjà graffités, le fait de ne pas se précipiter en dehors du magasin pour vandaliser les commerces d’à côté, sont autant de règles qui permettent d’établir une hiérarchie entre les nouveaux venus et les anciens du métier, et de participer à l’élaboration d’une communauté de graffeurs aux valeurs partagées.
Le litige, quand il prend une ampleur plus grande peut aussi donner naissance à une remise à plat d’un fonctionnement ayant facilité les déviances, en vue d’en éviter la répétition. Plus spécifiquement, dans le cas de scandales mêlant le milieu des affaires et le monde politique, on s’attache alors à « rebâtir des parois étanches » entre des secteurs dont l’interpénétration produit le désordre (Blic, 2005, p. 71). Les mesures de « moralisation de l’argent » prises après le scandale de Panama l’illustrent : condamnations bien sûr des coupables, mais aussi « conseils pratiques » édictés à destination des petits épargnants et diagnostic sur le rôle des médias (dont certains étaient corrompus) en vue de l’élaboration d’une charte professionnelle… : « Les scandales permettent ainsi d’expliciter des règles dont on s’aperçoit alors que, si elles sont a priori partagées, elles ne manquent pas moins d’une définition admise par tous » (idem, p. 77). Le scandale de la MNEF a ainsi reposé à nouveaux frais la question des collusions entre un parti politique et une Mutuelle dont la diversification des activités s’est avérée périlleuse : la création de La Mutuelle Des Étudiants (LMDE) en 2000 réaffirme alors la nécessité de remettre au centre des décisions les élus étudiants et d’en finir avec les dérives affairistes de leurs prédécesseurs. Les récentes mesures de « moralisation de la vie politique » à la suite du scandale autour des comptes bancaires du ministre délégué au Budget Jérôme Cahuzac en offrent aujourd’hui encore un singulier écho.
Références
-
Bamberger P. A., Sonnenstuhl W. J., 1998. Deviance in and of organizations, numéro spécial de Research in the Sociology of Organizations, XV.
-
Becker H. S., 1963 [1985]. Outsiders. Études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié.
-
Boltanski L., 1990. L’Amour et la Justice comme compétences. Trois essais de sociologie de l’action, Paris, Métailié.
-
Boltanski L., 2009. De la critique. Précis de sociologie de l’émancipation, Paris, Gallimard.
-
Bonnet F., 2008. Un crime sans déviance : le vol en interne comme activité routinière, Revue française de sociologie, 49-2, 331-350.
-
Cefaï D., Costey P., 2009. Codifier l’engagement ethnographique ? Remarques sur le consentement éclairé, les codes d’éthique et les comités d’éthique, La Vie des idées, URL : http://www.laviedesidees.fr/Codifier-l-engagement.html
-
Chateauraynaud F., Torny D., 1999. Les sombres précurseurs. Une sociologie pragmatique de l’alerte et du risque, Paris, Éditions de l’EHESS.
-
Dodier N., 1995. Les Hommes et les machines. La conscience collective dans les sociétés technicisées, Paris, Métailié.
-
Durkheim É., 1893 [2004]. De la division du travail social, Paris, PUF.
-
Durkheim É., 1895 [1999]. Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF.
-
Felstiner W. L., Abel R. L., Sarat A., 1980-1981. The emergence and transformation of disputes: naming, blaming, claiming…, Law and Society Review, vol. 15, n° 3/4, 631-654.
-
Fontaine L., Weber F. (dir.), 2010. Les paradoxes de l’économie informelle. À qui profitent les règles ?, Paris, Karthala.
-
Hirschman A. O., 1995 [1970]. Défection et prise de parole [Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States], Paris, Fayard.
-
Lascoumes P., 1985. Des erreurs, pas des fautes. La gestion discrète du droit des affaires, Paris, Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales.
-
Lascoumes P., 1986. Les affaires ou l’art de l’ombre. Les délinquances économiques et financières et leur contrôle, Paris, Editions du Centurion.
-
Lemieux C., 2007. A quoi sert l’analyse des controverses ?, Mil Neuf Cent, 25, 191-212.
-
Offenstadt N., Van Damme S. (dir.), 2007. Affaires, scandales et grandes causes : De Socrate à Pinochet, Paris, Stock.
-
Sachet-Milliat A., 2009. La délinquance d’affaires. Les défis méthodologiques des recherches en terrain sensible, Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements, 15-35, 95-115.
-
Shaw C. R., 1930 [1966]. The Jack-Roller: A Delinquent Boy’s Own Story, Chicago, University of Chicago Press.
-
Simon D. R., Hagan F. E., 1999. White Collar Deviance, Needham Heights (MA), Allyn & Bacon.
-
Sutherland E. H., Conwell C. (pseudonym), 1937. The Professional Thief: by a Professional Thief. Annotated and Interpreted by Edwin H. Sutherland, Chicago, University of Chicago Press.
-
Thrasher F., 1927. The Gang. A Study of 1,313 Gangs in Chicago, Chicago, University of Chicago Press.
-
Venkatesh S. A., 2006. Off the Books. The Underground Economy of the Urban Poor, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
-
Venkatesh S. A., 2009. Gang Leader for a Day, New York, Penguin.
-
Whyte F. W., 1955 [2002]. Street Corner Society, Paris, La Découverte.
Notes
« Affaire », définition in Le Petit Robert de la langue française, 2009.
On trouve ici une distinction dont l’anglais rend également bien compte, comme en atteste le titre « Deviance in and of organizations » du numéro spécial de Research in the Sociology of Organizations coordonné par Peter A. Bamberger et William J. Sonnenstuhl en 1998.
La distinction entre « scandale » et « affaire » renvoie à une différence de configuration des rapports de force entre l’accusation et l’accusé. Ainsi, le « scandale » désigne une situation dans laquelle une communauté se montre parfaitement unie dans l’accusation, et où l’accusé ne rencontre jamais personne qui prenne publiquement sa défense, lui-même ne s’y aventurant guère. L’« affaire », en revanche, évoque une situation dans laquelle deux camps s’opposent (celui des accusateurs de l’accusé et celui des accusateurs de l’accusation) et où, compte tenu de l’indétermination qui plane sur le choix de la victime et du coupable, tout retournement des positions semble possible (Blic et Lemieux, 2005).
Les difficultés de terrain rencontrées par W. F. Whyte sont notamment listées dans un appendice ajouté en 1955 à son ouvrage (initialement publié en 1943) qui raconte aussi les petits écarts au droit qu’il a cru devoir commettre pour se faire accepter (la fraude électorale notamment).
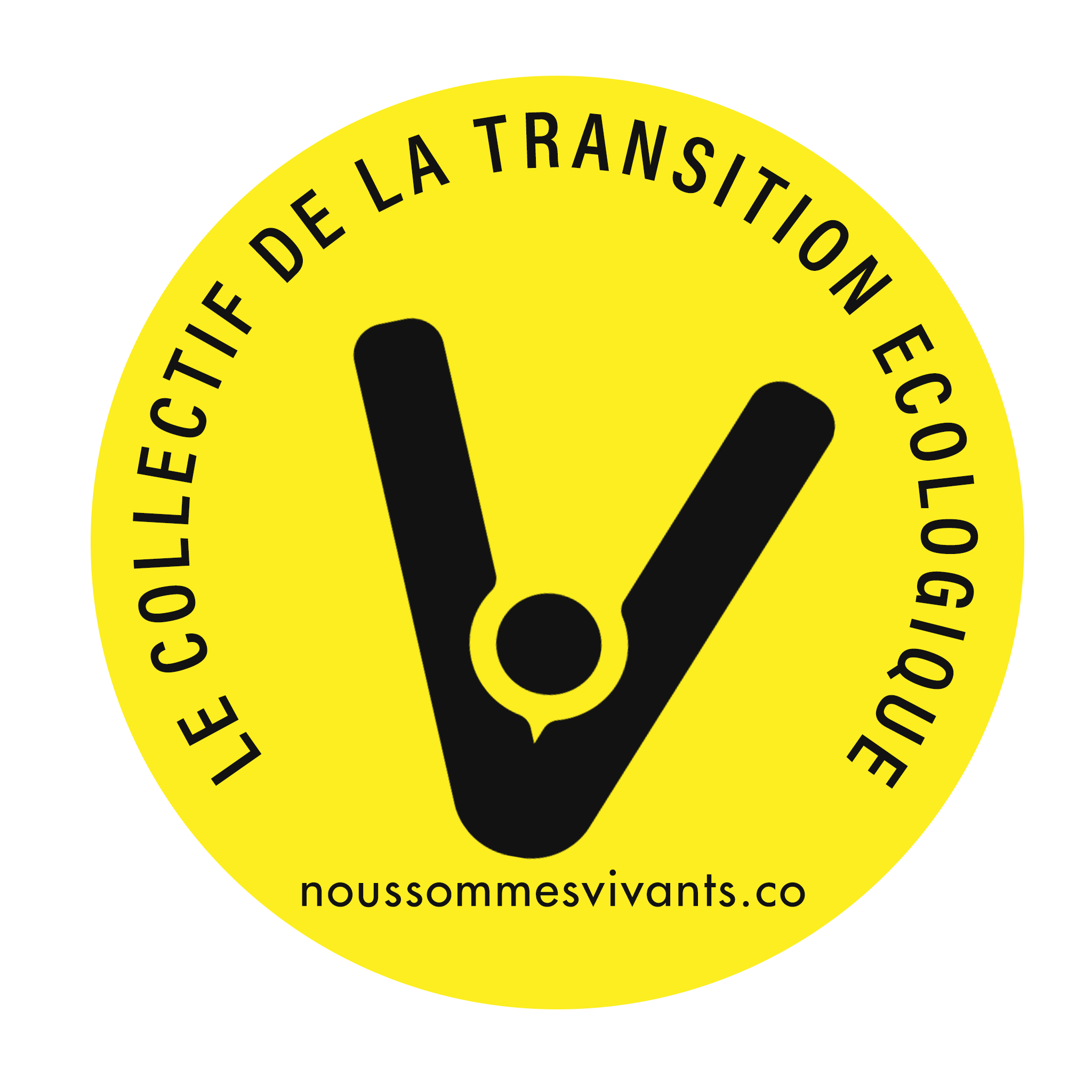


Laisser un commentaire