|
|
Le mot « sens » (en anglais, purpose) semble appartenir à une autre époque — un temps plus propice à la réflexion — où les cellulaires et les horaires surchargés n’existaient pas encore. Or, c’est ce mot qu’a choisi l’auteur Aaron Hurst pour décrire un ensemble de changements qui s’opèrent dans l’économie mondiale.
Dans son nouveau livre, The Purpose Economy: How Your Desire for Impact, Personal Growth and Community is Changing the World, M. Hurst prétend que la quête de sens et la recherche d’un esprit de communauté au travail mènent à de nombreux changements qui, ensemble, indiquent que le sens devient le nouveau moteur de l’économie mondiale.
Des marchés publics voient le jour partout. De nombreux jeunes de la génération Y fuient les cheminements de carrière traditionnels : ils lancent plutôt leur propre entreprise technologique, mettent sur pied de petites entreprises dans leur région ou deviennent travailleurs autonomes. C’est aussi l’ère du partage : on partage son vélo, sa voiture, et même les pièces libres de sa maison, peut-on lire dans un communiqué au sujet du livre. Il se crée, dans les collectivités, beaucoup de produits artisanaux, que l’on achète et vend facilement.
Voilà quelque temps déjà que l’économie de l’information stimule l’innovation et la croissance économique. Mais l’économie du « sens » (purpose economy), qui se nourrit des technologies, des médias sociaux et du partage des ressources, a pour objectif de permettre à chacun de trouver un sens à ses actions. « Dans mon livre, j’explique que la rencontre entre le marché et les individus s’effectue lorsque chacun invente sa propre façon de trouver un sens à son travail », souligne Aaron Hurst.
Selon l’auteur, ce que nous croyons savoir sur le sens est faux : « Il est clair que le sens n’est pas une cause, ni une révélation, ni un luxe. Le sens est ce que nous tirons de nos relations, de notre épanouissement personnel et de la réalisation de quelque chose qui nous dépasse. »
Les jeunes entreprises comme Etsy, Zaarly, Tough Mudder, Kickstarter et Airbnb trouvent de nouvelles façons de créer de la valeur en nous reliant à nos collectivités locales, lit-on dans le communiqué. Parallèlement, de grandes sociétés, par exemple Tesla et Whole Foods, qui se contentaient auparavant de ne s’adresser qu’à une clientèle aisée, prennent les mesures nécessaires pour devenir des marques grand public.
Aaron Hurst a d’ailleurs lui-même vécu le changement qu’il décrit. En 2001, il a quitté un emploi bien rémunéré dans le domaine des technologies pour lancer la Fondation Taproot, organisme sans but lucratif qui s’assure le concours de professionnels offrant leurs services à titre gracieux (http://www.taprootfoundation.org/about-probono/about-taproot). M. Hurst est également fondateur et chef de la direction d’Imperative (http://www.imperative.com/).


Par Ghislain Deslandes – Professeur à l’ESCP Europe et directeur de programme au Collège International de Philosophie
Et si le sens de la vie professionnelle, le sens que nous donnons aux efforts que nous faisons au travail, était en train de devenir le cœur du développement économique ?
Cette question qui peut paraître un peu utopique à un européen, est posée par un essayiste américain dans la deuxième édition de son livre, Purpose Economy. Pour Aaron Hurst en effet l’économie de l’information, celle des tableaux de bord et des indicateurs de performance, est en train d’évoluer radicalement. Cette révolution, c’est celle du dépassement de la rationalité des moyens, des méthodes, des techniques, notamment incarnées par la figure du manager, par la rationalité des fins, les fins éthiques et écologiques. Plus simplement dit : le besoin que nous avons d’enrichir nos relations à autrui et celui de participer au développement de l’humanité sont en train de prendre le pas sur d’autres considérations. L’auteur de rappeler les résultats de deux études souvent citées : celle réalisée à Princeton qui a montré qu’au-delà de 75000$ de revenu annuel, l’humeur et la satisfaction des gens ne changent plus. Et l’autre par PricewaterhouseCoopers au dernier World economic forum qui montrait que les consommateurs sont eux-mêmes en quête de sens plutôt que d’un prix ou d’une fonctionnalité.
Le raisonnement consiste à montrer que le développement des activités non-lucratives, dont Hurst est spécialiste, que l’on constate partout dans le monde infuse en quelque sorte au delà de son périmètre propre. Notre essayiste de citer de nombreuses sociétés dont le succès dépend de ce souci communautaire ou écologique comme seventh generation, fabricant de produits d’hygiène biodégradable notamment pour les enfants, la Khan Academy qui a délivré gratuitement 300 000 leçons depuis ses débuts et touche 10 millions d’étudiants dans le monde, la plateforme Kickstarter qui accompagne et finance des projets artistiques et culturels ou encore Medium qui permet à de jeunes auteurs de recevoir des commentaires de la part de leurs pairs directement en ligne.
Devant autant d’enthousiasme deux remarques peuvent être cependant adressées à l’auteur : la première est l’imprécision de cette notion de « purpose » dont on peut dire qu’elle concerne toutes les entreprises qui ont une finalité, une direction, un dessein à faire valoir au bénéfice de la communauté. Mais dans ce cas quels sont les critères qui permettent de distinguer valablement une bonne finalité d’une mauvaise : le texte est imprécis sur ce point important, alors qu’il est sensé déterminer toute la méthode.
Le second aspect concerne le projet de cet ouvrage qui est aussi de lutter contre le sentiment de 70% de personnes qui se disent, selon une étude Gallup, désengagés au travail. Le livre compte en cela sur les ressources de la recherche en psychologie positive dont les américains sont si friands. Certes faire de la vie organisationnelle un lieu humainement plus satisfaisant est un objectif fondamental pour les études en gestion : mais distinguer à ce point les organisations en considérant les unes comme un lieu de détresse, et les autres comme un lieu de plaisir intense ne peut valablement constituer un point de départ plausible. Il est important de savoir aussi vivre avec des émotions négatives, tristesse, colère ou incertitude qui non seulement font parti de notre humanité mais qui sont souvent la ressource ultime permettant aux organisations d’éviter de commettre d’irréparables bêtises.
Or il faut rappeler que c’est précisément le rôle d’un management éclairé, dont le texte annonce un peu vite la disparition prochaine, que d’être capable d’accompagner la détermination de ces deux points : la visée de l’organisation et le respect de la diversité de ses membres.
Entreprendre avant de prendre. Patrick Storhaye
Entreprendre c’est fondamentalement bâtir un projet qui donne envie et offre une perspective réaliste de satisfaction des intérêts de toutes les parties prenantes.
Un projet dont la portée, l’ambition et les perspectives de gains transcendent les intérêts particuliers au point de devenir un Bien Commun. Un bien qui résiste à l’épreuve du quotidien et aux inévitables tiraillements qu’il impose. Une ambition supérieure qui permet à chacun de ne pas chercher à maximiser coûte que coûte son bien-être ou son profit immédiat, mais de faire fi des imperfections de la vie, des efforts inutiles, des erreurs et des errances, pour une raison simple : chaque acteur est intimement convaincu que sa contribution sera honnêtement reconnue.
En l’absence d’une telle perspective, l’entreprise s’expose à deux risques :
- les meilleurs tenteront d’autres aventures sous d’autres cieux (chez les concurrents par exemple) ou d’autres formes (en devenant par exemple des indépendants)
- les plus faibles, contraints par la force des choses, continueront à souffrir, exposant ainsi l’entreprise sur les plans juridique, financier et moral.
Oublier qu’entreprendre relève du besoin vital, parce que le travail permet à l’Homme de se révéler à lui-même, revient à réunir les conditions de l’assèchement. Les entreprises qui font le pari du formidable potentiel de motivation des personnes disposeront d’un capital d’une richesse infinie. Les autres verront leur structure se vider lentement de leur meilleure ressource, jusqu’à ce qu’elles ne deviennent que de simples assembleurs de services, réalisant alors la prophétie des « nouveaux marchands » (Boyer & Scouarnec, 1999), selon laquelle la compétence individuelle se monnaierait comme un service ou se regrouperait en petites structures.
https://www.linkedin.com/pulse/entreprendre-avant-de-prendre-patrick-storhaye/
« La seule voiture au monde jamais construite dans la joie ».
Ce titre insolite est celui d’un chapitre du scénario du film de Jean Rouch, long-métrage non moins étrange, sélectionné à Venise en 1984 et intitulé Dionysos. Celui-ci raconte l’histoire d’un Professeur d’art dramatique américain, Hugh Gray, qui décide d’avancer la date de sa soutenance de thèse consacrée à « Dionysos, ou la nécessité du culte de la nature dans les sociétés industrielles ». Reçu à l’examen, il sera ensuite invité à mettre sa théorie au diapason de sa pratique et à cet effet prend la responsabilité d’une usine de fabrication de voiture Citroën. Et ce face au scepticisme de Bruno : « Comment transformer un “atelier-tristesse”, un “atelier-désespoir”, en un “atelier-plaisir” ? Voyez, Hugh, comment voulez-vous que les ouvriers qui travaillent au “prototype” prennent la moindre joie à faire ce qu’ils font puisqu’ils n’investissent rien ; leur tâche a été morcelée, éparpillée entre différents établis, des parties d’un tout qui n’existe que dans la tête de l’ingénieur. Eux, on leur demande de tailler la pierre d’angle de la pyramide mais sans jamais voir la pyramide ». De cet atelier-là sortira pourtant la première 2CV panthère parfumée. Pour construire cette voiture, Hugh-Dionysos y propose en effet : « de mettre une estrade, une scène sur laquelle tout le monde pourra voir naître la voiture que tous auront fabriquée ! Le régleur de carburateur sera aussi concerné que le dessinateur ou la couturière de la sellerie : ils sauront tous pourquoi et sur quoi ils travaillent.. Et si ça marche… Et ça marchera ! On va faire la première voiture fabriquée dans la joie ! » (Rouch, 1999, p. 51). D’abord incrédules, les ouvriers se montrent de plus en plus enthousiastes face à ce dialogue entre « mythe antique » et monde manufacturier, entre harmonies musicales et industrielles. Ce récit est présenté comme celui d’un « miroir à double face… la joie sur une face, le travail sur l’autre et, aux milieux, entre ces faces opposées, cet espace fragile et étroit où se glissent ceux qui aiment ce qu’ils font… ». (ibid., p. 47).
La joie au travail semble se distinguer nettement de la joie au sens du management.
La joie au travail serait intrinsèque au travail lui-même et secondairement à la production d’une œuvre capitale pour son auteur (et dont l’évaluation, incalculable, resterait subjective). La joie managériale se focaliserait plus exclusivement, non sur le travail lui-même, mais sur le seul critère du résultat, calculable celui-là, réalisé au regard de buts fixés à l’avance. Le travailleur se soucierait de lui-même et de son œuvre, ou de lui-même comme œuvre, tandis que le manager, grâce à des techniques de contrôle plus ou moins contraignantes, userait du travail d’autrui et du sien propre pour atteindre des objectifs hétérodéterminés, de nature généralement quantitative, liés à l’évaluation d’un volume. D’un côté une forme supérieure de joie possible, de l’autre une forme équivoque, et souvent disqualifiée aux yeux des philosophes, de plaisir. De cette sorte de plaisir irrémédiablement liée au bien-être économique en général dont Scitovsky (1976) note d’ailleurs que, s’il croît régulièrement, il ne nous rend pas plus heureux pour autant.
Les études menées sur la situation des managers à l’égard de leur activité nous apprennent qu’ils sont précisément, sans être les seuls bien entendu, la catégorie la plus touchée par le stress (Méda et Vendramin, 2013), la fatigue, le burn-out (Chabot, 2013) etc. mais également par toutes sortes de problèmes de santé comme les TMS (troubles musculo-squelettiques notamment les lésions articulaires), la dépression nerveuse, la consommation exagérée d’anxiolytiques, les problèmes de peau, de cœur, de tension, etc. Auteur d’un essai consacré au burn-out, Pascal Chabot explique que celui-ci : « est en train de devenir une véritable épidémie dans de nombreux pays du globe. Nous ne sommes pas en cause, c’est le monde et la nature du travail qui ont fondamentalement changé. L’univers professionnel – que ce soit l’entreprise, l’hôpital, l’école ou les services publics – est devenu froid, hostile et exigeant, sur le plan tant économique que psychologique. Les individus sont émotionnellement, physiquement et spirituellement épuisés. Les exigences quotidiennes liées au travail, à la famille et à tout le reste ont fini par éroder leur énergie et leur enthousiasme. La joie de la réussite et la satisfaction d’avoir rempli ses objectifs sont de plus en plus difficiles à atteindre, et le dévouement et l’engagement professionnel sont en train de disparaître » (Chabot, 2013, p. 27). Pourquoi les managers sont-ils souvent plus touchés que d’autre par cet épuisement moral et spirituel, voilà qui prête à interrogation. Cette desaffectio societatis ne serait-elle pas ce qui serait le stade d’une perte totale du sentiment d’agentivité, d’une sorte d’après burn-out plus ou moins généralisé ? Tout se passant comme si le « burn-out » comme écrit Chabot, était « la maladie du “bon américain”, si par ce terme l’on entend l’Américain qui rêve en phase avec les valeurs dominantes du travail ». Les managers seraient en fait porteurs d’un discours appauvri sur le travail, dont ils seraient les premières victimes, un discours aussi éloigné que possible du gaudium, de la joie latine. « Comment se plaindre objectivement d’une situation à laquelle on a longtemps adhéré, et dont on a espéré, et quelquefois obtenu, des bénéfices réels ? », questionne notamment Bouilloud (2012, p. 44). Bénéfices réels qui font penser aux satisfactions faciles et régulières qu’évoquera Nietzsche, lesquelles abolissent la qualité au profit de la quantité, et qui ajoute à la « bêtise systématique » des élites décrite par Bernard Stiegler, « privées de savoir sur leur propre logique et par leur propre logique » (2009, p. 68).
Privées de savoir peut-être, mais qui n’en ressentent pas moins au plan affectif, que quelque chose ne fonctionne plus. D’où ces phénomènes de perte de foi dans leur propre rôle, remarquablement décrits par le sociologue américain Robert Jackall (1988), d’individus désaffectés, insatisfaits à l’égard d’eux-mêmes et qui n’ont même plus, comme dit aussi Stiegler, la capacité de défendre le capitalisme « contre lui-même » (2006, p. 174). Les managers paraissent prisonniers de modèles de gestion (toyotisme, taylorisme, downsizing, empowerment, etc.) comme fixés, au siècle dernier, une fois pour toutes. Ils peinent à sortir de paradigmes fonctionnalistes et positivistes (de Gaulejac, 2012) qui ne permettent plus semble-t-il de répondre à la complexité des problèmes d’aujourd’hui.
https://journals.openedition.org/leportique/2818?lang=en
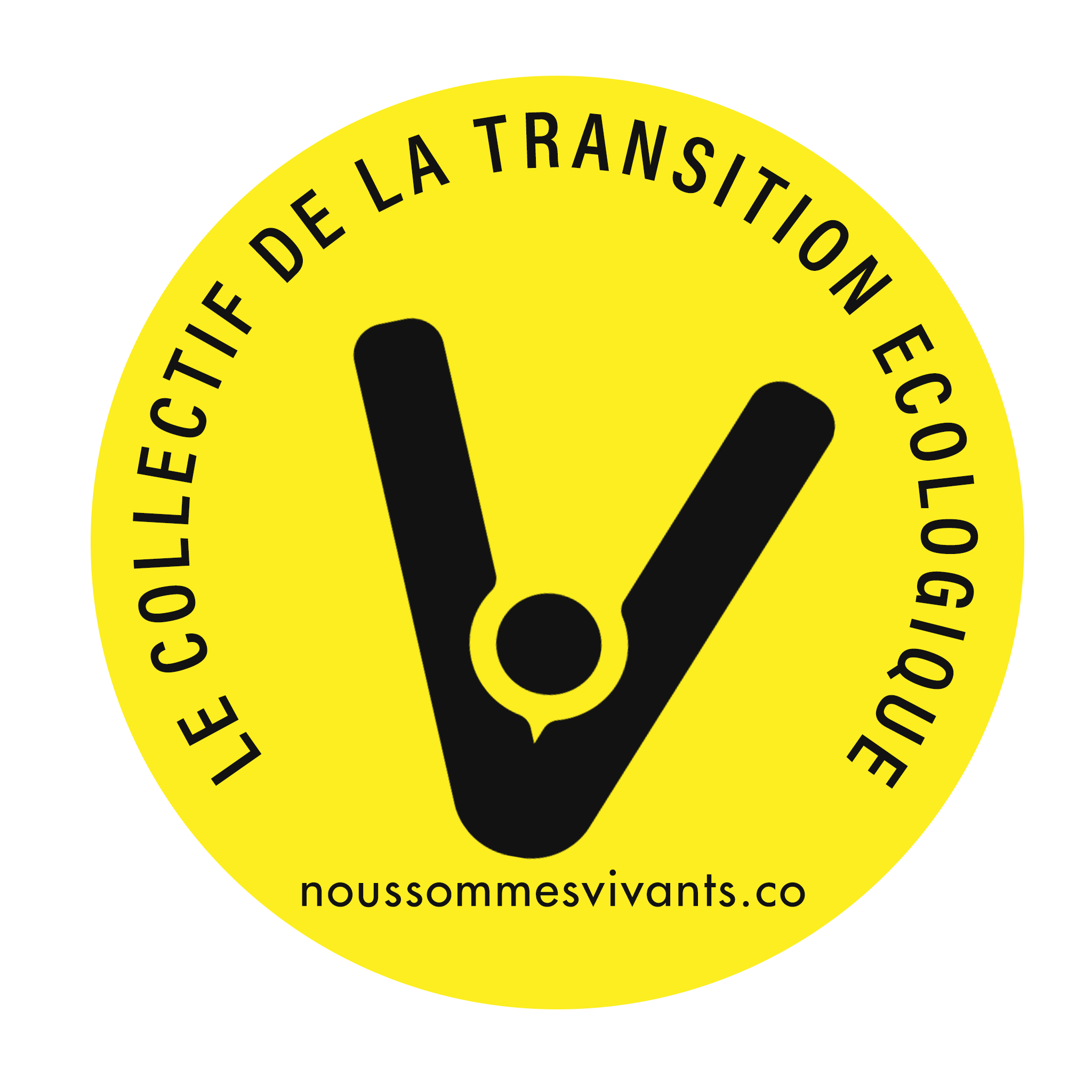
Laisser un commentaire