Même si les capacités de réflexion d’un collectif sont supérieures à
celles d’un individu, la pertinence de leurs résultats est limitée par
les effets de groupe et les méthodes que se donnent les organisations.
La fonction d’une organisation,
quelle qu’elle soit – entreprise, groupe de travail, équipe de
chercheurs, conseil d’administration -, est d’amener ses membres à
réfléchir, décider et agir ensemble. Etre à plusieurs pour réfléchir
est certainement un avantage : on peut se répartir le raisonnement en
tâches plus simples, examiner davantage d’options, enrichir
mutuellement les idées des uns et des autres, vérifier les calculs de
chacun.
A priori, la rationalité d’un collectif devrait
être supérieure à celle d’un individu, nécessairement limité par ses
capacités à s’informer et à penser. Mais cette rationalité collective
se heurte à d’autres limites, qui proviennent des formes mêmes de la
réflexion et de la décision à plusieurs. Une organisation possède une
intelligence propre qui la rend plus efficace qu’un individu seul. Mais
cette intelligence collective, pour fonctionner, doit utiliser des
processus spécifiques comme le travail en groupe et la coordination
implicite. Et ces processus présentent des risques propres de
dysfonctionnement qui peuvent détériorer cette intelligence collective.
L’organisation
moderne est caractérisée par des principes tels que la division du
travail, des règles impersonnelles et des actions méthodiques. Or ces
principes mêmes, et en dépit de qualités par ailleurs avérées,
lorsqu’ils sont appliqués à des collectifs, sont à la source de
certains silences qui induisent des effets contre-productifs.
Notamment, ils font obstacle à la perception et à la compréhension de
problèmes qui peuvent être graves.
LES FORMES DU SILENCE
La première forme de ces silences est la tendance à ne pas
répéter ni accentuer les alertes. En effet, l’organisation moderne se
veut impersonnelle et rationnelle : on ne crie pas, on n’insiste pas,
on utilise des signaux standardisés, on ne manifeste pas de sentiments
personnels.
Par exemple, une note ou un message d’alerte grave
peut parfaitement, par sa forme et son style, ressembler à une note de
routine. Souvent, les acteurs jugent qu’une alerte émise n’a pas besoin
d’être répétée. Cette forme de silence est à l’origine de cas célèbres
d’erreurs collectives. Lors d’une réunion décisive pour le lancement de
la navette Challenger (qui allait exploser en vol le 28 janvier 1986),
plusieurs ingénieurs se sont tus parce qu’ils estimaient inutile de
reparler des défauts des joints responsables de l’accident après qu’un
autre participant les eut déjà évoqués (1).
On sait aujourd’hui qu’en 1961, lors des séances préparatoires de
l’opération de la baie des Cochons convoquées par le président John F.
Kennedy, le secrétaire d’Etat Dean Rusk et l’assistant du président
Arthur Schlesinger se sont retenus d’exprimer leurs hésitations, alors
que J.-F. Kennedy était prêt à les écouter (2).
On connaît aussi deux cas d’incidents aériens ayant tourné à la
catastrophe parce que les pilotes ont appliqué le principe de sobriété
d’expression avec les contrôleurs, alors qu’ils auraient dû crier leur
détresse.
En réalité, comme l’ont montré les travaux d’Amos
Tversky et de son école, l’intelligence humaine est dépendante de la
mise en relief des messages, qui ne sont perçus que s’ils sont
« saillants ». Ce principe est au coeur de la méthode dite du
« management visible » appliqué au Japon dans l’industrie, en
particulier automobile, et dans certaines entreprises européennes. Il
consiste à mettre en évidence, notamment dans les ateliers, les
informations importantes en utilisant des présentations simplifiées,
des symboles voyants et des répétitions de messages. Par exemple, un
ouvrier signalera un problème sur une chaîne en allumant un feu
d’alerte visible de partout alentour. De même, la méthode du « juste à
temps » est considérée par ses fondateurs (Kiichoro Toyota et son
conseiller Taichi Ohno) comme un instrument de mise en lumière des
problèmes. En effet, quand on dispose seulement des pièces nécessaires
pour la demi-journée de production qui suit, la moindre difficulté
(défaut, rupture d’approvisionnement) éclate immédiatement au grand
jour. Les stocks, en revanche, permettent de masquer toutes sortes de
problèmes. Le management visible et le « juste à temps » sont des
procédures destinées à lutter contre le silence organisationnel qui
masque les problèmes.
L’atténuation des désaccords est également
à l’origine de certains silences dommageables. C’est un fait
paradoxal : le bon fonctionnement d’un groupe de travail exige des
manières policées, mais cette politesse peut mener le collectif à
ignorer les problèmes et à faire des erreurs. Même dans les réunions de
crise, les responsables s’efforcent de rester calmes et polis. C’est un
défaut de la « pensée de groupe » selon Irving L Janis.
QUAND PERSONNE NE DIT CE QU’IL PENSE
De même, la division poussée du travail peut induire des effets
de silence. Les participants à une réunion peuvent trouver avantage à
renvoyer la parole aux spécialistes, et ces derniers, estimant le cas
trop complexe, la renvoyer aux généralistes. Résultat : personne ne dit
ce qu’il pense. Dans le cas de la navette Challenger, les spécialistes
affirment avoir retenu leur avis critique parce qu’ils pensaient que le
problème concernait, de manière plus large, les managers. Et
ces derniers se sont tus parce qu’ils ne se sentaient pas experts en
matière de joints. C’est encore plus vrai lorsque des sujets ou des
projets sont à cheval sur deux ou plusieurs spécialités et ne rentrent
dans aucun cadre préétabli.
Outre la taille des groupes, qui peut
rendre impossible la prise de parole de tous les participants, un
dernier facteur de dangereux silences peut être identifié. Dans les
organisations modernes, en effet, l’intuition n’a pas droit à la
parole : toute argumentation doit être appuyée sur des faits. L’intime
conviction n’est pas un principe de raisonnement collectif, même s’il
est présent chez les individus. Les faits (statistiques notamment) sont
infiniment mieux acceptés et pris en compte que des opinions ou des
sentiments. Globalement, c’est un progrès. Mais dans le détail, c’est
un handicap considérable. Dans l’affaire de la navette, la décision de
procéder au lancement un jour de grand froid a été prise malgré un
sentiment d’inquiétude des ingénieurs. Ces derniers, en effet, ne
disposaient pas de données synthétiques sur le comportement des joints
à basse température atmosphérique. Faute de faits, on est passé outre.
C’est une pratique courante en marketing. Le marketing
d’aujourd’hui est fondé sur le recueil rigoureux des opinions des
consommateurs. Il aboutit à concevoir des produits qui satisfont les
habitudes d’un consommateur moyen qui n’existe pas. En revanche, il est
impossible de prouver par des études qu’un produit innovant va marcher.
Les échecs répétés de certaines entreprises, qui se refusent à procéder
à des choix instinctifs, viennent de là. En ne suivant que les
« faits », les organisations sont condamnées à répéter des erreurs dont
il est difficile de prouver l’origine.
Ainsi, comme on le voit,
les organisations modernes utilisent des procédures de délibération
faites pour lutter contre les biais de la rationalité individuelle : on
standardise, on favorise l’expression impersonnelle pour compenser les
biais de l’individu, trop sensible à la conviction et aux messages
saillants ; on a recours aux faits pour combattre l’intuition. Mais
cette rationalité collective introduit à son tour des sources majeures
d’erreurs difficiles à corriger.
LES BONNES MÉTHODES SONT-ELLES SI BONNES ?
Afin d’améliorer le travail en groupe, les organisations
modernes mettent en place des méthodes souvent sophistiquées.
Réfléchies, rigoureuses, elles ne peuvent, pense-t-on, qu’être plus
efficaces qu’une absence de méthode. Mais leurs effets ne sont pas si
assurés, notamment parce qu’elles échouent à améliorer la réflexion
collective.
Par exemple, il existe une méthode de travail en
réunion qui connaît un grand succès, celle que j’appellerai des
« papillons jaunes ». Sur les questions à l’ordre du jour, chaque
participant écrit chacune de ses idées sur un papillon collant. Les
papillons sont ensuite placés sur un tableau et regroupés en fonction
des remarques de l’assistance. Puis on procède à un vote pour donner un
ordre de préférence aux groupes d’idées. En règle générale, il n’en
sort rien de concret. Cette méthode facilite l’expression des
participants, mais noie les problèmes importants dans un ensemble
d’idées vagues. Les acteurs, pour respecter le format des papillons,
énoncent des formules globales, et les regroupements accentuent la
tendance à produire des idées générales. On pourrait en dire autant des
méthodes de travail par sous-groupes, qui consistent à diviser
l’assemblée en petits groupes qui réfléchissent entre eux, puis
délèguent un rapporteur à l’assemblée générale. Le plus souvent, la
restitution est pauvre, confuse et reste très générale. Ces exemples
donnent l’illusion de processus bien organisés et ouverts de gestion
participative des problèmes. En réalité, ils n’empêcheront pas qu’une
erreur collective persiste, parce que ces méthodes ne permettent pas
vraiment à ceux qui sont conscients de l’erreur de la faire remonter.
D’autres
méthodes ont pour objectif d’améliorer le fonctionnement des réunions
classiques. Par exemple, on se donnera un ensemble de règles visant à
organiser l’action : fixation d’un ordre du jour détaillé et exclusif,
minutage du temps de parole, tour de table démocratique, obligation de
prendre une décision en fin de réunion, rédaction d’un compte-rendu de
séance, etc. Ces règles paraissent de bon sens, mais elles mènent
souvent à un excès d’organisation qui, en fait, réduit la réflexion.
Ainsi, un ordre du jour rigide empêche de parler d’une difficulté non
prévue, ou de développer une idée fructueuse. Le tour de table
démocratique distribue la parole de façon non pertinente. L’obligation
de prendre une décision oblige à se précipiter. Au bout du compte, il
apparaît que la recherche d’un ordre collectif ne se traduit pas
forcément par une rationalité accrue des décisions par rapport à ce que
serait celle d’un individu solitaire, forcément limité.
Toutefois,
ce genre d’effet ne résulte pas seulement des procédures de
délibération collective. Il émane aussi de la combinaison des conduites
individuelles. Dans les organisations, les acteurs se guident en bonne
partie sur des anticipations croisées. Thomas Schelling appelle « point
focal » la solution de compromis que les parties anticipent sans
communiquer directement. Claude Michaud et Jean-Claude Thoenig
considèrent que beaucoup d’organisations fonctionnent à l’aide de
corridors d’action : chaque acteur sait ce qu’il doit faire, et sait ce
que l’autre va faire et sait que l’autre sait ce qu’il sait.
QUAND CHACUN SE TROMPE, TOUT LE MONDE SE TROMPE
Ces anticipations sont, en moyenne, extrêmement rentables :
prescrire toutes les actions de chacun serait une perte de temps, à
supposer que cela soit possible. Mais cette rationalité procédurale a
aussi ses limites. Quand chacun croit savoir ce que l’autre pense, il y
a un risque d’erreur. Un grand nombre de collisions de navires
proviennent d’anticipations croisées a priori raisonnables.
Dans les cockpits d’avions de ligne, où en principe tout message doit
être explicitement verbalisé, il arrive que les pilotes commettent ce
genre d’erreur : par exemple, face à un commandant qui ne réagit pas,
le copilote pense qu’il confirme son identification du réacteur
défectueux, ce qui n’est pas le cas ; ou encore, un officier mécanicien
estime que le commandant de bord a de bonnes raisons de ne pas se
soucier du niveau de carburant, alors que ce dernier compte sur lui
pour réagir si la baisse devient inquiétante. Dans la vie quotidienne,
l’anticipation permet aux personnes qui se perdent de se retrouver, ou
au contraire de faire exactement l’inverse de ce que chacun attend. La
rationalité procédurale des anticipations croisées est à la fois un
moteur puissant de l’action collective et un facteur d’erreurs fatales.
L’agrégation
de raisonnements individuels imparfaits représente également un facteur
de limitation de la rationalité. Il a été démontré par des psychologues
que les individus ont beaucoup de mal à penser en arborescence,
c’est-à-dire à combiner des étapes conditionnelles successives. Un
groupe a encore plus de difficulté à raisonner de cette manière. Cette
difficulté provient des mécanismes mêmes de l’interaction : on passera
beaucoup de temps sur une dimension du problème et on fera l’impasse
sur la seconde ; on cherchera un compromis impossible ; on se laissera
distraire par une question pertinente et on négligera l’essentiel. Par
exemple, dans une usine où se côtoient une porte avec barrière et
gardien et une autre ouverte sans surveillance, chacun individuellement
admet que c’est absurde. Mais, en comité de direction, la discussion
sur les choix possibles et leurs conséquences (deux portes gardées, une
gardée et une fermée, etc.) devient si confuse qu’aucune décision n’est
prise.
Ensuite, certains biais individuels deviennent d’autant
plus problématiques qu’ils sont partagés et produisent un « effet de
masse ». Si, dans une entreprise, un individu croit à la validité
d’échantillons statistiques de taille ridicule pour des sondages
d’opinion, il se trouvera un expert pour lui expliquer qu’il se trompe.
Mais si tous les cadres partagent cette conviction, alors l’expert n’y
pourra rien, et les indicateurs dénués de sens deviendront des
standards de référence pour l’entreprise.
Du fait de la
rationalité collectivement limitée, l’organisation moderne peut
apparaître ainsi moins « intelligente » qu’un individu. Par exemple, il
est quasiment impossible pour un groupe de rédiger collectivement un
document d’information clair et pertinent
Pourtant, il est
évident qu’un groupe est capable de réalisations qui sont hors de la
portée d’un individu : interpréter une symphonie, construire un avion,
transplanter un organe. Comment expliquer ce paradoxe ? C’est que la
rationalité collectivement limitée des organisations modernes produit à
la fois des objets extraordinaires, et beaucoup de « bruit ». Ce bruit
est masqué par le caractère extraordinaire des objets et reste en
général imperceptible, sauf en cas d’accident. Ainsi, les plus belles
réalisations collectives sont-elles à la merci d’erreurs pourtant
prévisibles. Les sociologues de l’école de Berkeley ont pris le
porte-avions comme exemple même de l’organisation complexe et fiable.
Mais le son discordant de l’hélice du Charles-de-Gaulle nous rappelle que le bruit de la rationalité collectivement limitée se fait toujours entendre quelque part.
NOTES
1 D. Vaughan, The Challenger Launch Decision: Risky technology, culture, and deviance at NASA, University of Chicago Press, 1996.
2 I.L. Janis, Groupthink: Psychological studies of policy decisions and fiascos, Houghton Mifflin, 1982.
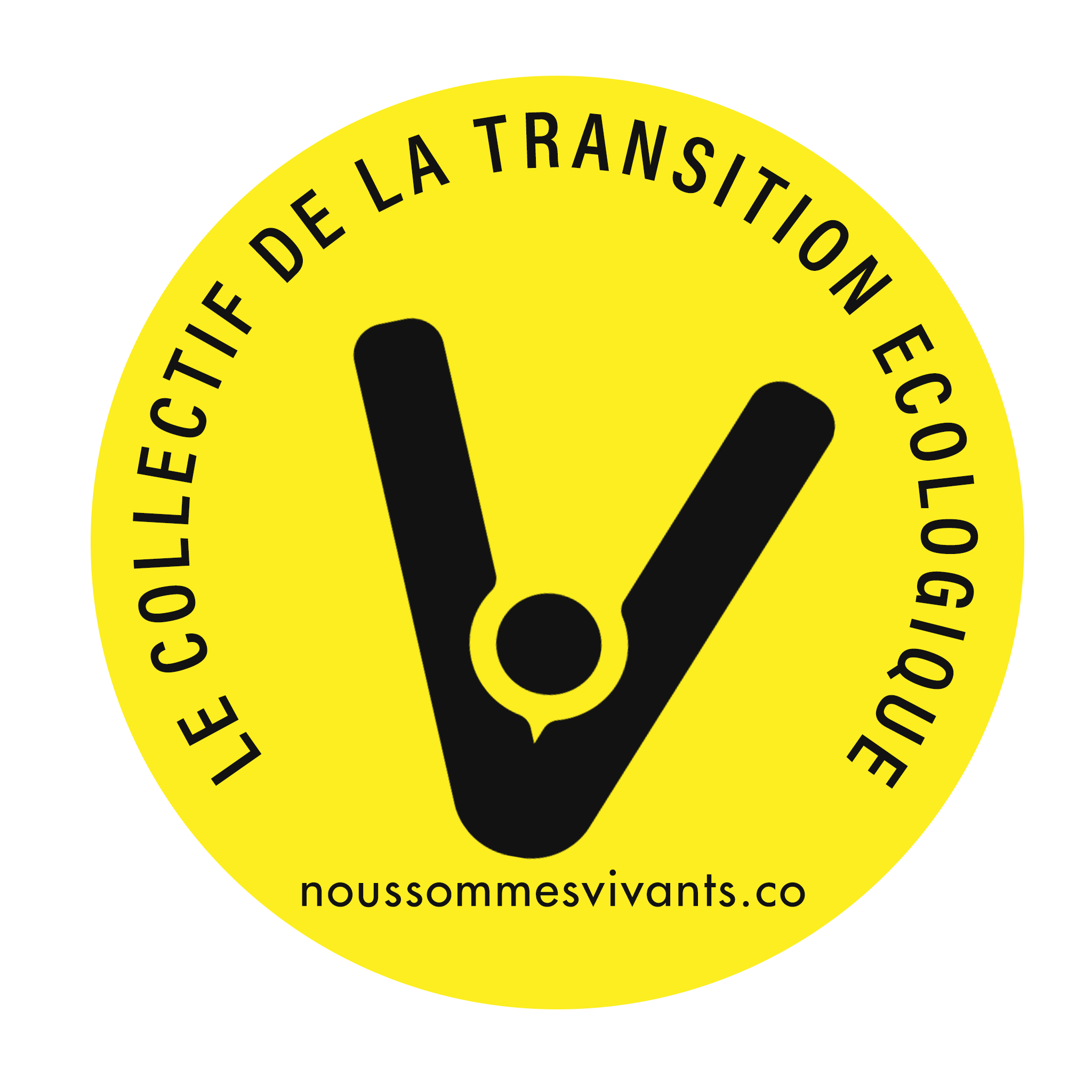

Laisser un commentaire