
http://www.journal.dnd.ca/frgraph/Vol4/no1/images/McIntyre-4-fig3_f.gif
La cause est entendue
: la gestion du savoir – ou son équivalent en anglais, « knowledge management
», qui a le mérite de sonner moderne – est à la mode. Qui souhaiterait lancer
aujourd’hui un moteur de recherche sur « knowledge management » serait dans l’incapacité
de trier les références obtenues (pages en français sur le moteur http://www.voilà.fr),
comme si tout relevait aujourd’hui du knowledge management. Victime de son succès,
l’expression « gestion du savoir » abrite aussi bien ce qui relève de la gestion
des données, des systèmes informatiques, etc. Alors, diront les esprits narquois,
encore un thème à la mode qui subira le même sort que la direction par objectifs
dans les années 60, l’enrichissement des tâches dans les années 70, le manager
minute dans les années 80 ou le reengineering dans les années 90 ? Est-il urgent
d’attendre la prochaine décennie pour la prochaine mode ? Pas si sûr. Il me semble
que cette mode risque de durer… longtemps, dans la mesure où nous sommes en
train de vivre un phénomène de fond qui vient structurer différemment nos économies,
ce qui a des implications profondes sur le management des entreprises.
Tout d’abord, il faut prendre conscience que ce qui produit la richesse des nations,
pour parler comme Adam Smith, est en train de changer. Le savoir prend la place
tenue autrefois par la terre, puis, au début de ce siècle, par l’énergie. Nous
sommes en train de vivre une transformation de nos économies d’une amplitude sans
précédent. L’homme considéré comme le plus riche de la planète, Bill Gates, n’a
pas construit sa richesse en pressant l’éponge pétrolière du Texas, mais sur ses
idées. Pour faire court, on pourrait résumer cette transformation en soulignant
que le savoir devient l’élément principal de ces économies, et son mode de production,
l’apprentissage. Pour utiliser une métaphore, on pourrait dire que le savoir devient
l’équivalent de ce qu’était la machine-outil pour les industries du début du siècle.
Au niveau des entreprises, le savoir deviendrait matrice de l’organisation,
et l’apprentissage, son mode de construction. On parle de « knowledge based economy
» pour caractériser la part croissante de l’intangible dans la valeur des produits.
On parle également d’économie « sans poids ». Ces économies sans poids sont des
économies où la transformation physique de la matière n’apparaît plus : une marque
commerciale, une police d’assurance, un morceau de logiciel, le décryptage d’un
code génétique, un film, tout cela ne pèse pas, mais produit une valorisation
économique largement supérieure aux tonnages de ciment ou d’acier (que l’on compare
le chiffre d’affaire du film « Titanic » à celui d’une entreprise métallurgique).
Evidemment, cela ne veut pas dire pour autant que les industries dites
« à cheminée d’usine » (« smokestack industries ») ont disparu. Elles ont su se
transformer en opérant de gigantesques gains de productivité : c’est le cas de
l’acier, qui a su survivre en intégrant les technologies de l’information ; c’est
aussi le cas de l’industrie automobile, qui a su complètement redéfinir son mode
de production.
La mentalité dite « move the metal » qui consistait, pour
chaque poste de travail amont, à « bouger la ferraille » vers l’aval a fait place
à une mentalité où l’on pense à l’envers, comme surent le faire les Japonais.
L’aval informe, c’est-à-dire donne forme à l’amont. Allant sur place pour observer
leur façon de faire des voitures, les constructeurs automobiles américains et
européens sont inquiets et un peu déboussolés quant à l’idée de perdre leurs repères
tayloriens. Ils reviennent du Japon soulagés, abandonnant l’explication exclusivement
« culturelle ». Les Japonais leur disent simplement leur souci de faire circuler
en permanence les connaissances implicites, leur refus d’isoler et de récompenser
des individus, mais plutôt de favoriser l’échange entre les personnes (jeunes
et vieux) et de relier en permanence savoir et action au travers des groupes de
projet. Nous voilà plongés du même coup dans le champ d’une gestion du savoir
que l’on peut qualifier d’implicite. Les industriels comprennent alors que les
gains se sont cachés dans des mécanismes invisibles, subtils. Citons-en quelques-uns
pour mieux définir ce que recouvre la gestion du savoir tacite : la façon de coordonner
les activités autrement que par des procédures et des règles formelles, la capacité
de réagir vite et à tous les niveaux en acceptant de partager l’information, la
volonté de préserver en permanence une mémoire collective en favorisant l’échange
quant aux façons de faire. Résumons-nous : le fait de favoriser les communications
implicites entre les personnes (sous toutes les formes), le fait de favoriser
les innovations peu flamboyantes qui développent l’apprentissage collectif, voilà
des recettes qui sont finalement assez simples à énoncer. « Mais on sait bien
tout cela ! » pourrait nous faire remarquer un lecteur ravi qui, finalement, pratiquerait
le knowledge management sans le savoir.
Privilégier
l’intangible
Tout le problème consiste précisément à traduire
dans les faits, et non dans les séminaires, cette prise de conscience, et cela
tous les jours et à tous les niveaux de l’entreprise. Cela consiste à protéger
le savoir tacite comme source de création de richesse. Nous parlons ici du savoir
comme une ressource intangible, et c’est précisément là le problème, dans la mesure
où cette ressource ne peut pas être allouée selon des buts et des objectifs précisément
définis. Le savoir circule dans la tête des salariés qui travaillent sur un même
projet, qui discutent ensemble de leur pratique et qui échangent leurs émotions,
leurs perceptions… Bref, je ne fais que décrire cette fameuse et mystérieuse
« mayonnaise » qui va faire l’échec ou le succès d’un groupe qui travaille sur
temps long et garanti, et dont les membres se sentent solidairement responsables
de la sortie d’un produit (un rapport, une recommandation, un cahier des charges,
un procédé, une application nouvelle…). Disant cela, on pourrait dire aujourd’hui
que toutes les entreprises françaises privilégient les groupes de travail et que,
finalement, il n’y a rien de nouveau sous le soleil.
C’est ne pas comprendre
qu’il faut tirer jusqu’au bout les conséquences d’une telle démarche privilégiant
l’intangible : favoriser l’autonomie (opérationnelle, financière) d’un groupe
qui travaille sur un projet et le placer pendant un temps défini (pouvant aller
jusqu’à un an ou plus) hors hiérarchie, veiller à ce que les espaces physiques
favorisent le partage des informations, ne pas tuer les idées naissantes sous
couvert de réunions de créativité qui ne sont que des caricatures de réunions
où le cerveau ne risque pas d’être secoué par une tornade, protéger le groupe
contre toutes les pressions. C’est cette humilité à admettre l’incapacité à vouloir
tout codifier tout en favorisant l’expression individuelle et collective qui fait
toute la difficulté de l’affaire. Dans les entreprises, les pratiques se savent
mais ne se disent pas (« Il fallait m’en parler, je t’aurais dit ce que je savais
sur ce projet »). Comme on aime le faire remarquer chez Hewlett Packard, qui est
loin d’être à la traîne en matière de knowledge management : « Ah! si HP savait
tout ce que HP sait ! »
Dans les entreprises qui sont encore mécanistes,
c’est-à-dire des entreprises ordonnées à l’image d’un jardin à la française, cette
gestion du savoir va s’avérer difficile dans la mesure où l’on privilégie la codification
et la standardisation (manuels, procédures, organigrammes…). La gestion du savoir
sera certes introduite mais vite transformée en outil. Le jeu du « faire semblant
» sera pratiqué – souvent avec talent – par ceux qui préfèrent les mots aux choses.
Le fait que le savoir tacite, celui qui est difficile à codifier, doit être
préservé, voire volontairement cultivé, a des conséquences profondes sur le management
des entreprises. Dans le cadre de cet article, j’en prendrais seulement deux,
l’une touchant à la relation que le salarié entretient avec son entreprise, l’autre
mettant en cause l’exercice du pouvoir par la rétention de l’information.
Dans une économie du savoir, il faut bien comprendre que celui-ci n’est pas
un produit comme un autre. Lorsque vous donnez une tablette de chocolat à quelqu’un,
vous ne l’avez plus. Rien de tel avec le savoir : ce que je sais, je peux le transmettre
(en écrivant par exemple cet article), mais je n’ai pas perdu ce que je sais pour
autant. Autrefois, les entreprises étaient propriétaires des outils que les salariés
utilisaient selon des procédures prescrites pour exécuter un travail précisément
défini. La situation aujourd’hui est complètement différente, dans la mesure où
la nature du travail a changé et aussi les attentes de l’entreprise.
De plus en plus d’entreprises exigent des salariés de la responsabilisation, de
l’implication. L’éloge de l’incertitude et du paradoxe va de pair avec la capacité
des salariés à prendre des initiatives ou, comme disent mes étudiants, d’« assurer
». Peut-on dire que les entreprises sont propriétaires du savoir que leurs ingénieurs
mobilisent dans leurs têtes en faisant du jogging pour imaginer un produit nouveau
à mettre le plus rapidement possible sur le marché ? Que faire lorsqu’un ingénieur
quitte « armes et bagages » une entreprise pour une autre (pas forcement concurrente)
avec son savoir en poche ? Avant, on déposait son outil, maintenant il est difficile
de déposer son savoir.
C’est tout le lien de la firme avec le salarié
qui est en train de changer, dans la mesure où ce dernier construit son autonomie
professionnelle dans l’entreprise tout en pouvant la valoriser en dehors. Comment
va réagir l’entreprise pour redéfinir les droits de propriété intellectuelle ?
Comment va-t-elle redéfinir son lien avec des salariés de plus en plus dubitatifs
quant au discours managérial sur la loyauté ? Ce sont les entreprises de consultants,
les plus exposées à ces questions, qui ont su, les premières, trouver des réponses
en mettant en place des outils qui permettent de gérer un véritable portefeuille
des savoir-faire de leurs consultants qui acceptent les règles du jeu de carrières
fortement différenciées (ceux qui restent, ceux qui partent).
Le deuxième
exemple, celui du partage de l’information comme condition requise de l’apprentissage
organisationnel, prend à contrepied les canons du management classique. Cette
question du partage, de la mise en commun des pratiques, est au centre de la gestion
du savoir. Là encore, les barrières vont se dresser dans les organisations qui
peuvent être qualifiées de « bureaucratiques ». Là, on y on observe des réunions
à comprendre comme des cérémonials dont le but est de mettre en espace les statuts
hiérarchiques ou professionnels et non pas le partage de savoir. La réunion, pourtant
l’outil de coordination par excellence, n’est pas un lieu de travail : très souvent,
celui qui sait est bien souvent celui qui se tait. Rien de tel dans les entreprises
qui pratiquent consciemment une gestion du savoir tacite et pour lesquelles celui
qui sait doit partager ce qu’il sait avec d’autres, faire circuler librement et
sans craintes ses façons d’approcher les problèmes, rendre compte des erreurs
et des succès de tel ou tel projet et les garder en mémoire pour en tirer des
leçons pour résoudre d’autres problèmes à venir.
Encore une fois, les
principes pour faire en sorte que la création de savoir soit possible dans les
entreprises sont finalement simples à énoncer. Les entreprises pour lesquelles
l’innovation est une question de survie ont bien compris l’enjeu et n’hésitent
à soigner particulièrement les facteurs d’émergence de ce savoir tacite tels que
le temps (se protéger de la pression, varier les rythmes de travail) et l’espace
(favoriser le partage par des architectures nouvelles). Pour aller jusqu’au bout
de la démarche, il y a décidément du pain sur la planche.
Jean-Michel
Saussois
Jean-Michel Saussois est professeur au département « stratégie,
hommes et organisation » du Groupe ESCP.
Il coordonne les enseignements d’organisation
et de management et dirige un programme de management public.
Il travaille
actuellement avec le centre de recherche sur l’éducation de l’OCDE (Ceri-OCDE)
sur le management du savoir dans les économies apprenantes (rapport OCDE à paraître
en février 2000).
http://www.lesechos.fr/formations/manag_info/articles/article_6_6.htm
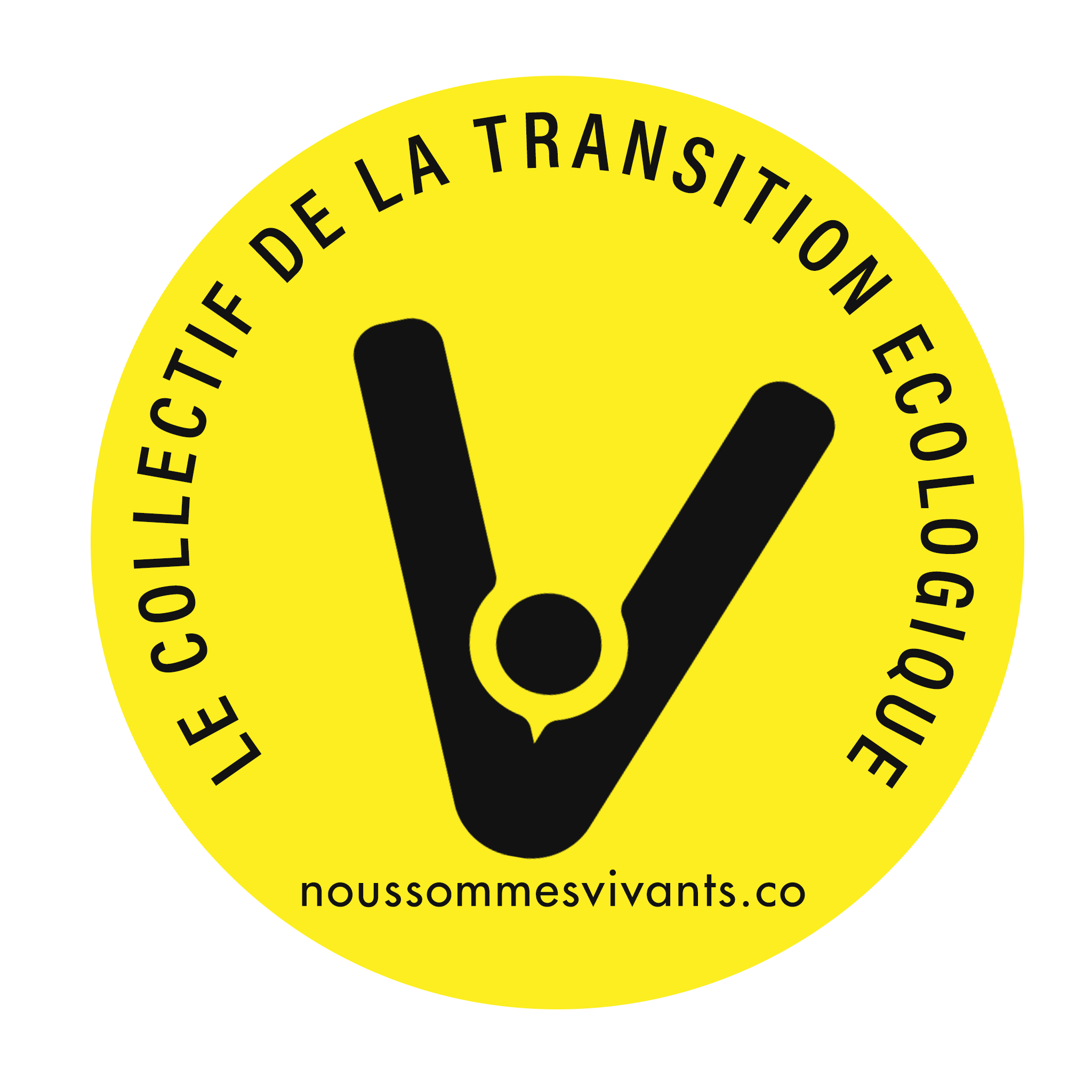
Laisser un commentaire