Le fil des idées
– Dans une société qui oppose les experts à
“ceux-qui-ne-comprennent-pas”, le philosophe Jacques Rancière, auteur
du “spectateur émancipé” insiste sur la nécessité de réhabiliter la
capacité de penser de chacun. Et démonte quelques clichés comme la
valeur critique de l’art, l’utilité des intellectuels ou l’opposition
entre parole et image.

Jacques
Rancière est un perceur de fenêtres. Il ouvre des brèches lumineuses
dans un monde des idées pris en étau entre le détachement cynique et
l'empilement de « diagnostics » sur les maux de notre société.
Politique, esthétique, éducation : quel que soit le terrain, il cultive
depuis trente ans une même philosophie, celle de l'émancipation. Une
philosophie qui rompt avec la distinction ancestrale entre « savants »
et « ignorants » – entre « ceux qui expliquent » et la masse qui les
écoute – et fait briller l'idée d'une participation de tous à
l'exercice de la pensée. Car « les incapables sont capables », répète souvent l'auteur du magnifique Maître ignorant (1987). Simplement, repérer leurs capacités et leurs compétences exige un « déplacement du regard ». Dans son dernier essai, Le Spectateur émancipé, Jacques Rancière (68 ans) explore justement ce regard pour démonter un des grands clichés de notre temps, celui de « l'homme aliéné par l'excès d'images ». Et pour nous aider à ajuster notre vision.
Dans votre dernier essai, Le Spectateur émancipé,
vous avancez l’idée que la capacité critique de l’art, et du coup sa
faculté de mobilisation, sont aujourd’hui en berne. Qu’entendez-vous
par là ?
Il fut un temps où l'art portait clairement un message politique et où
la critique cherchait à déceler ce message dans les œuvres. Je pense à
l'époque de Bertolt Brecht, par exemple, où le théâtre dénonçait
explicitement les contradictions sociales et le pouvoir du capital, ou
aux années 1960 et 1970, quand s'est développée la dénonciation de la
société du spectacle, avec Guy Debord : on pensait alors qu'en montrant
certaines images du pouvoir – par exemple un amoncellement de
marchandises ou des starlettes sur les plages de Cannes – on ferait
naître chez le spectateur à la fois la conscience du système de
domination régnant et l'aspiration à lutter contre. C'est cette
tradition de l'art critique qui, selon moi, s'essouffle depuis
vingt-cinq ou trente ans.
Il ne suffirait donc plus de montrer ce qu’on dénonce pour faire descendre les gens dans la rue ?
Le problème est que ça n'a jamais suffi. Aux XVIIe et XVIIIe siècles,
on se disait : montrons le vice et la vertu au théâtre, cela incitera
les hommes à fuir le premier et à honorer la seconde. Dès le XVIIIe,
pourtant, Rousseau a montré que ça ne marchait pas : si les spectateurs
prennent plaisir à la représentation du vice, on imagine mal qu'ils
s'en détournent après la pièce. Et si certains ont plaisir à voir la
vertu sur scène, cela ne signifie pas qu'ils se réjouiront de la
pratiquer dans la réalité. Peu à peu, on a mis en évidence qu'il n'y
avait aucun effet direct entre l'intention de l'artiste et la réception
du spectateur. Plus proche de nous, voyez les montages de l'artiste
Martha Rosler, qui insérait des photos de la guerre du Vietnam – en
l'occurrence un homme portant un enfant mort – dans des publicités pour
des intérieurs américains. Bel exemple d'« art critique » qui espère
vous faire réagir ! Pourtant, cette œuvre ne vous mobilise que si vous
êtes déjà convaincu, d'une part, que ce qui est critiqué dans l'image
est l'impérialisme américain, d'autre part que les Américains sont
impérialistes. Sinon, vous avez l'impression d'être devant une image de
propagande.
“Les pièces de Brecht ou les images
dénonçant la société de consommation
ne font plus effet aujourd'hui.”
Pourquoi ?
Parce que ce type de représentations « critiques » suppose un système
cohérent d'explication du monde : tant que le marxisme offrait ce
système et un horizon pour l'Histoire, les pièces de Brecht ou les
images dénonçant la société de consommation faisaient effet. Ce n'est
plus le cas aujourd'hui. D'abord, ces images « critiques » sont
omniprésentes dans la société contemporaine : quelle expo n'offre pas
son étalage de marchandises chargé de nous faire découvrir les horreurs
de la consommation ? Ou ses icônes médiatiques en résine censées nous
révéler la vérité sur le « spectacle » ? Mais elles ne révèlent rien du
tout : tout le monde est conscient que la marchandise est partout !
Jeff Koons à Versailles ou un artiste comme Paul McCarthy ont beau nous
inonder de Pinocchio et d'ours en peluche censés nous alerter contre
l'empire du spectacle, ça ne fonctionne pas. Il n'y a plus rien à
révéler. Koons à Versailles, c'est la grosse entreprise artistique
accueillie par la grosse entreprise culturelle de l'Etat, l'art «
critique » devenu officiel, deux entreprises qui traitent de puissance
à puissance.
Mais s’il n’y a plus rien à révéler, à quoi sert l’art critique ?
Pour certains, comme Baudrillard, tout est apparence et il n'y a rien à
« sauver ». Ils annoncent du même coup l'échec et la fin de la
dénonciation des apparences sur laquelle reposait l'art critique. Je ne
partage pas leur analyse : je ne pense pas que tout soit apparence, «
écran » ou « communication », et je reste persuadé, au contraire, que
les formes de la domination sont aussi solides aujourd'hui qu'hier.
C'est plutôt le système d'explication du monde et l'idée d'une action
politique fondée sur cette vision du monde qui ont perdu de leur
crédibilité.
Un art critique est donc encore possible aujourd’hui ?
Oui, à condition de bousculer les stéréotypes et de changer la
distribution des rôles. Souvenez-vous par exemple de la phrase un peu
provocatrice de Godard, qui disait que l'épopée est réservée à Israël
et le documentaire aux Palestiniens. Que voulait dire Godard ? Que la
fiction est un luxe, et que la seule chose qui reste aux pauvres, aux
victimes, c'est de montrer leur réalité, de témoigner de leur misère.
Le véritable art critique doit déplacer ce type de partage fondamental.
Certains artistes s'appliquent d'ailleurs à le faire. Le dessin animé Valse avec Bachir,
par exemple, subvertit la forme documentaire. Et l'artiste Pedro Costa
aussi, lui qui filme des immigrés et des drogués dans les bidonvilles
de Lisbonne en leur permettant de construire une parole à la hauteur de
leur destin, en rendant la richesse matérielle de leur monde.
“Quand je regarde la télévision, je vois
beaucoup de gens qui parlent,
et très peu d'images de la réalité.”
Le statut de l’image fait aussi débat dans les médias.
Partagez-vous le scepticisme ambiant, qui affirme que nous sommes noyés
sous les images, et que celles-ci sont trop souvent violentes, voire
intolérables ?
Pas du tout. Quand je regarde la télévision – et plus
précisément les informations –, je vois beaucoup de gens qui parlent,
et très peu d'images, au fond, de la réalité. C'est le défilé des
experts, des gens venus nous dire ce qu'il faut penser du peu d'images
qu'on voit ! Il suffit de voir l'importance que le mot « décrypter » a
prise dans les médias. Et que nous disent ces experts ? A peu près ceci
: « Il y a trop d'images intolérables, on va vous en montrer un
tout petit peu, et surtout on va vous les expliquer. Parce que le
malheur des victimes, n'est-ce pas, c'est qu'elles ne comprennent pas
très bien ce qui leur arrive ; et votre malheur à vous,
téléspectateurs, c'est que vous ne le comprenez pas plus. Heureusement,
nous sommes là. »
par Olivier Pascal-Moussellard
Photos : Léa Crespi pour Télérama
Posté par : Loïc LAMY
Publié sur : levidepoches/planningstratégique
Source: Télérama
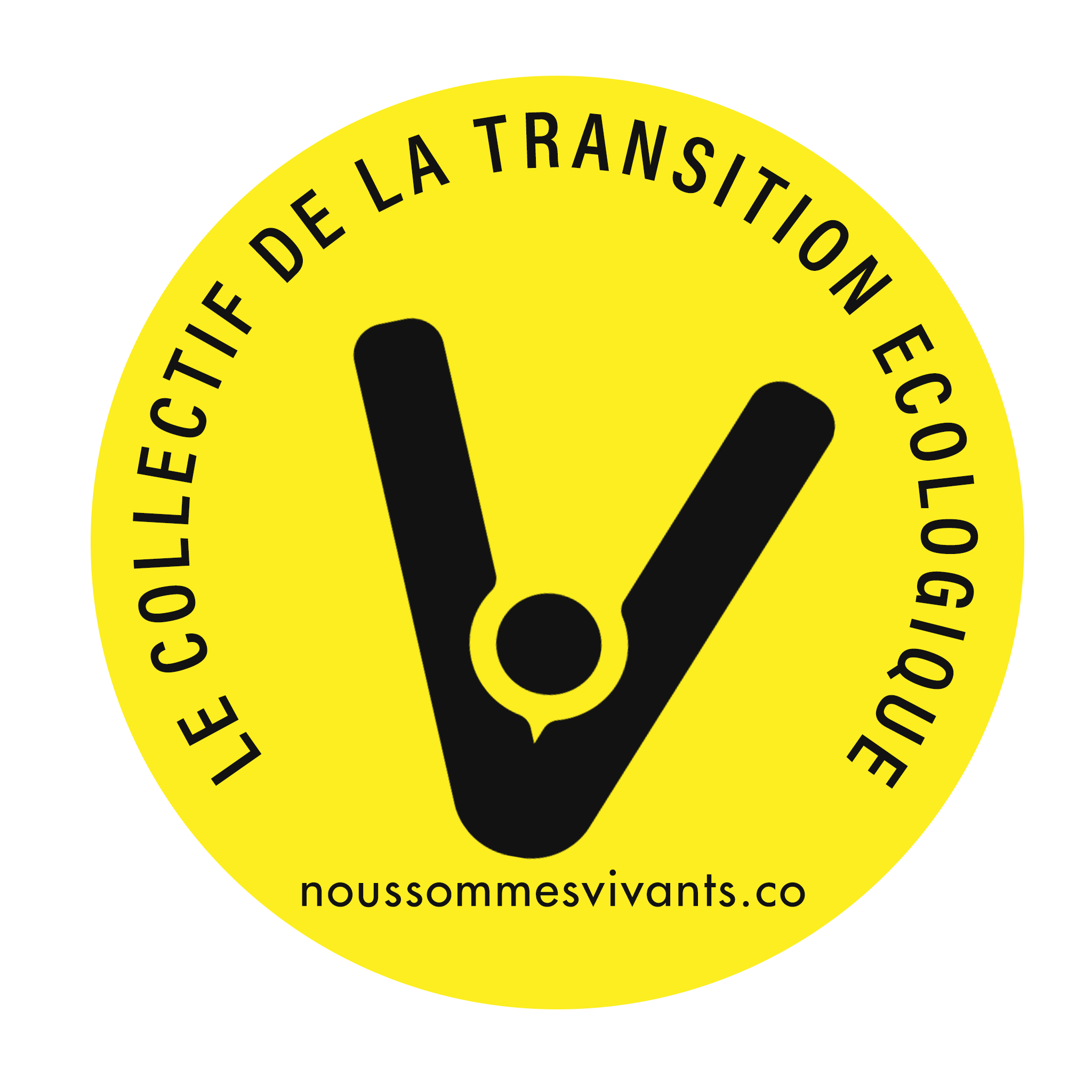
Laisser un commentaire