Etymologie : du verbe dévier, composé du préfixe de cessation de et du latin via, voie, route, chemin.
Dans ce passage du célèbre livre Outsiders (1963), Howard Becker critique différentes définitions de la déviance (statistique, médicale, fonctionnaliste…) pour ensuite proposer la sienne. Ce texte éclairant montre que l’analyse de la déviance ne peut se réduire à l’état, à la nature ou aux attributs de la personne dite déviante, que la déviance n’est pas simplement la violation de normes sociales, mais qu’elle est un processus qui oblige à considérer, outre le « déviant » lui-même, l’ensemble des individus qui le définissent — ou qui l‘étiquettent — comme tel (on a d’ailleurs pu parler de « théorie de l’étiquetage », mais il est intéressant de noter que, dans le chapitre 10 nommé « La théorie de l’étiquetage : une vue rétrospective (1973) », Becker conteste avoir voulu fonder une « théorie » dans ses premiers écrits).
L’extrait suivant couvre les pages 27 à 38 de l’ouvrage Outsiders traduit en Français et édité aux éditions Métailié (1985) Source : http://blog.bafouillages.net/2009/03/la-definition-de-la-deviance-par-howard-becker-dans-outsiders/
Définitions de la déviance.
De nombreuses spéculations, théories et études scientifiques ont été consacrées à ceux qui apparaissent comme étrangers à la collectivité parce qu’ils dévient de ses normes. Les profanes se posent, à propos de ces déviants, des questions telles que : pourquoi font-ils cela ? comment expliquer leur transgression ? qu’est-ce qui les conduit à faire des choses interdites ? Des recherches à caractère scientifique ont tenté de trouver des réponses à ces questions en prenant comme point de départ la conviction du sens commun selon laquelle il y a quelque chose de substantiellement déviant, de qualitativement distinct, dans les actes qui transgressent — ou semblent transgresser — les normes sociales. Ces recherches ont aussi emprunté au sens commun le présupposé selon lequel la réalisation d’un acte déviant découle nécessairement de certaines caractéristiques de son auteur, qui rendent la réalisation de cet acte nécessaire ou inévitable. Les chercheurs ne mettent généralement pas en question la qualification de « déviant » attribuée à des actes ou à des individus particuliers, mais ils la prennent au contraire comme une donnée. Ils admettent par là les valeurs du groupe qui prononce ce jugement.
Il est facile d’observer que ce ne sont pas les mêmes actions que les différents groupes qualifient de déviantes. Ceci devrait attirer notre attention sur la possibilité que les phénomènes de déviance lient étroitement la personne qui émet le jugement de déviance, le processus qui aboutit à ce jugement et la situation dans laquelle il est produit. Dans la mesure où les théories scientifiques, à l’instar des conceptions de la déviance propres au sens commun qui leur servent de point de départ, admettent que les actes sont substantiellement déviants et tiennent ainsi pour négligeables les propriétés des conditions et des processus du jugement, elles peuvent être conduites à exclure une variable importante. Par le fait même qu’ils méconnaissent le caractère variable du processus de jugement, les chercheurs risquent de restreindre la gamme des théories envisageables ainsi que le type d’intelligibilité proposé[1].
Notre premier problème est donc de construire une définition de la déviance. Mais avant d’en venir là, nous examinerons quelques-unes des définitions actuellement utilisées, en signalant ce que les recherches qui partent de ces définitions conduisent à négliger.
La conception la plus simple de la déviance est essentiellement statistique : est déviant ce qui s’écarte par trop de la moyenne. Quand un statisticien analyse les résultats d’une expérimentation agricole, il décrit les tiges exceptionnellement longues ou courtes comme des déviations par rapport à la moyenne ou a une autre valeur centrale. On peut décrire de même comme une déviation tout ce qui diffère de ce qui est le plus commun. Selon cette conception, les gauchers et les roux sont déviants puisque la plupart des gens sont droitiers et châtains.
Ainsi formulée, la conception statistique semble naïve et même triviale. Elle a toutefois le mérite de simplifier le problème en écartant de nombreuses questions de valeur qui surgissent généralement quand on étudie la nature de la déviance : pour estimer un cas particulier, il suffira de calculer la distance à la moyenne du comportement concerné. Mais c’est une solution trop simpliste. Armé d’une telle définition, l’enquêteur rapportera un peu de tout : des obèses et des grêles, des meurtriers, des roux, des homosexuels et des conducteurs en infraction. Ce mélange contient des individus habituellement tenus pour déviants et d’autres qui n’ont pas transgressé la moindre norme. En bref, la définition statistique de la déviance est trop éloignée de l’idée de transgression qui est à l’origine de l’étude scientifique des déviants.
Une conception moins simple et beaucoup plus répandue de la déviance, reposant à l’évidence sur une analogie médicale, définit la déviance comme quelque chose d’essentiellement pathologique, qui révèle la présence d’un « mal ». Mais s’il y a peu de désaccords sur ce qui caractérise un organisme en bonne santé, il y en a en revanche beaucoup plus quand on utilise analogiquement la notion de pathologie pour décrire des types de comportement qui sont considérés comme déviants. Pour caractériser le comportement sain, il est en effet difficile de trouver une définition propre à satisfaire même un groupe fermé et restreint de psychiatres, et il est impossible d’en trouver une qui puisse être généralement acceptée, comme c’est le cas pour les critères de la santé de l’organisme.[2]
On donne parfois à l’analogie une signification plus stricte lorsqu’on voit dans la déviance le produit d’une maladie mentale. Le comportement d’un homosexuel ou d’un toxicomane est alors considéré comme le symptôme d’une maladie mentale, au même titre que la lenteur de la guérison des contusions est considérée comme un symptôme du diabète. Mais la maladie mentale ne ressemble à la maladie physique que par métaphore :
« En partant de faits tels que la syphilis, la tuberculose, la fièvre typhoïde, les cancers et les fractures, nous avons créé une classe appelée « maladie ». Tout d’abord, cette classe se composait seulement de quelques éléments qui avaient en commun un trait indiquant un état de désordre structural ou fonctionnel du corps humain en tant que machine physico-chimique. Au fur et à mesure que le temps s’écoulait, on a ajouté à cette classe des éléments supplémentaires. Toutefois, on ne les a pas ajoutés parce qu’ils étaient des troubles corporels nouvellement découverts. L’intérêt et l’attention du médecin se sont écartés de ce critère et se sont centrés sur l’incapacité et la souffrance, choisis comme nouveaux critères de sélection. C’est ainsi que des faits tels que l’hystérie, l’hypocondrie, la névrose compulsive-obsessionnelle et la dépression se sont ajoutés, avec lenteur au début, à la catégorie « maladie ». Puis, avec un zèle croissant, les médecins, et en particulier les psychiatres, se sont mis à qualifier de « maladie » (c’est-à-dire bien sûr de « maladie mentale ») tout ce en quoi ils pouvaient détecter un signe de « dysfonctionnement » par rapport à n’importe quelle norme. Donc, l’agoraphobie est une maladie parce qu’on ne devrait pas craindre les espaces ouverts; l’homosexualité est une maladie parce que l’hétérosexualité est la norme sociale; le divorce est une maladie parce qu’il signe l’échec du mariage. Le crime, l’art, la politique de ceux dont on n’aime pas les opinions, la participation aux affaires sociales ou le retrait d’une telle participation — tous ces faits et beaucoup d’autres sont considérés, de nos jours, comme des symptômes de maladie mentale.[3] »
La métaphore médicale limite le point de vue tout autant que la conception statistique. Elle accepte le jugement profane sur ce qui est déviant et, par l’usage de l’analogie, en situe la source à l’intérieur de l’individu, ce qui empêche de voir le jugement lui-même comme une composante décisive du phénomène.
Certains sociologues utilisent eux aussi un modèle de la déviance qui repose, pour l’essentiel, sur les notions de santé et de maladie empruntées à la médecine. Ils examinent une société, ou une partie d’une société, en se demandant s’il s’y déroule un processus qui tend à en réduire la stabilité et à en diminuer ainsi les chances de survie. Ils qualifient de tels processus de déviants ou les définissent comme des symptômes de désorganisation sociale. Ils font une distinction entre les aspects d’une société qui, favorisant la stabilité, seraient « fonctionnels », et ceux qui, rompant la stabilité, seraient « dysfonctionnels ». Une telle conception a le grand mérite de suggérer des domaines de la société où peuvent exister des problèmes dont les individus ne sont peut-être pas conscients[4].
Mais il est plus difficile en pratique qu’il ne le semble en théorie de déterminer ce qui est fonctionnel et ce qui est dysfonctionnel pour une société ou un groupe social. La définition de la fonction, c’est-à-dire de l’intention ou du but d’un groupe et, par voie de conséquence, la définition des aspects qui favorisent ou qui entravent la réalisation de cette fonction, constituent très souvent une question de nature politique. Il y a, dans un groupe, des factions en désaccord qui manœuvrent pour faire prévaloir leur propre définition de la fonction. Ce qui est une fonction pour un groupe ou une organisation n’est pas inscrit dans leur nature, mais se décide dans un conflit de type politique. Si cela est vrai, il s’ensuit que la détermination des normes à respecter, des comportements réputés déviants et des individus désignés comme étrangers au groupe ou à l’organisation doit aussi être considérée comme une question de nature politique[5]. La conception fonctionnelle de la déviance, qui en néglige l’aspect politique, limite donc notre compréhension du phénomène.
Plus relativiste, une autre conception sociologique définit la déviance par le défaut d’obéissance aux normes du groupe. Quand on a décrit les normes qu’un groupe impose à ses membres, on peut décider avec une certaine précision si un individu a, ou non, transgressé celles-ci, et donc s’il est déviant.
Cette conception est plus proche de la mienne, mais elle ne parvient pas à donner une importance suffisante aux ambiguïtés qui surgissent quand il faut choisir les normes destinées à servir d’étalon pour mesurer le comportement et juger de sa déviance. Une société comporte plusieurs groupes, chacun avec son propre système de normes, et les individus appartiennent simultanément à plusieurs groupes. Une personne peut transgresser les normes d’un groupe par une action qui est conforme à celles d’un autre groupe. Est-elle alors déviante ? Ceux qui proposent cette définition objecteront peut-être que, si l’ambiguïté peut apparaître au regard des normes particulières de tel ou tel groupe de la société, il existe des normes qui sont très généralement reconnues par tous : dans ce cas il n’y aurait pas de difficulté. C’est là, bien sûr, une question de fait, qui doit être tranchée par la recherche empirique. Quant à moi, je doute qu’il y ait de nombreux domaines où un tel consensus existe, et j’estime plus raisonnable d’utiliser une définition permettant de traiter toutes les situations, qu’elles soient ambiguës ou non.
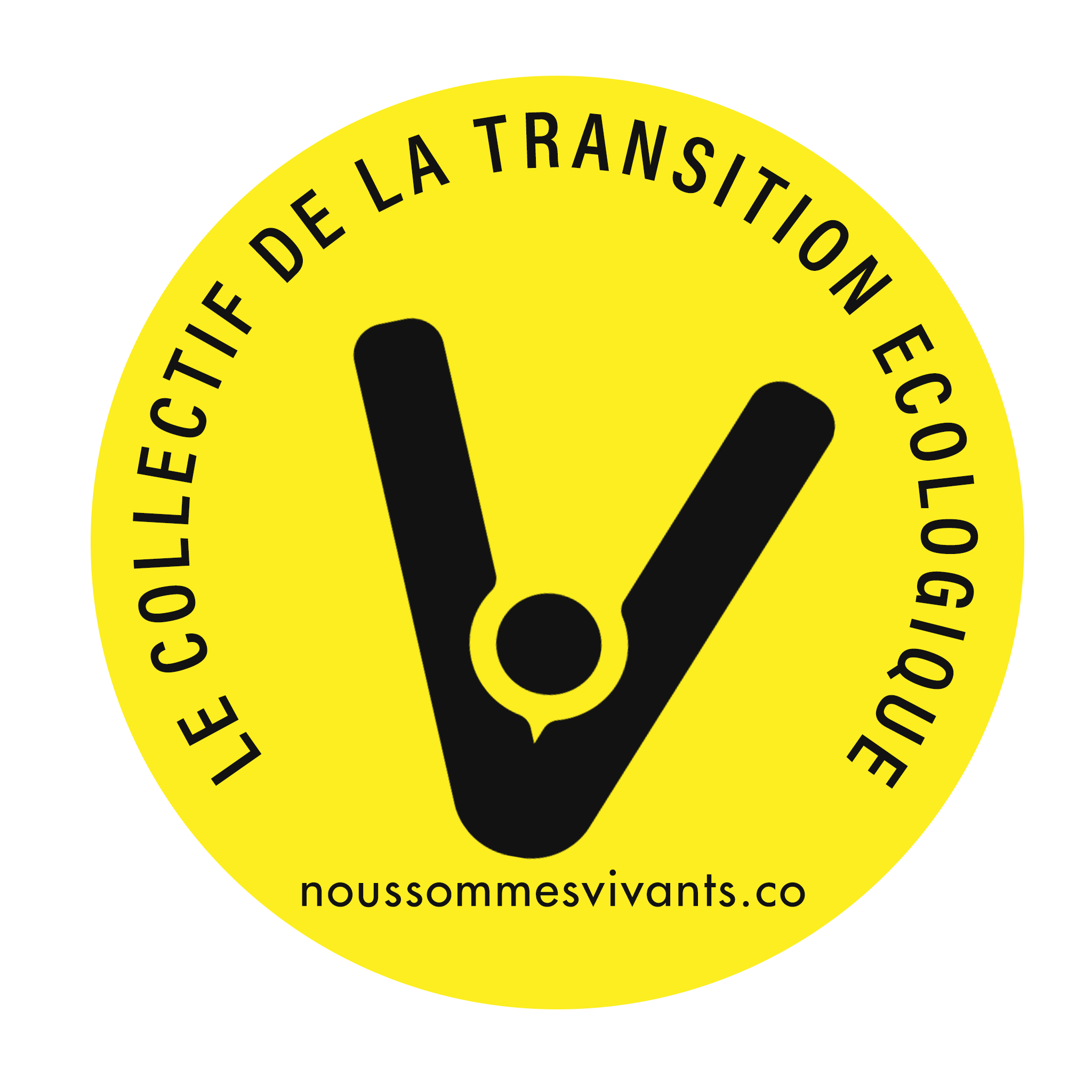
Laisser un commentaire